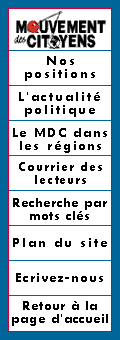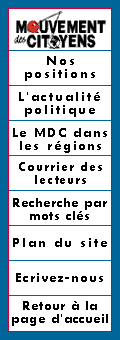|
Une dynamique de coopération doit s'installer
entre l'Etat, garant sur l'ensemble du territoire national de l'intérêt
général, et les collectivités locales confrontées
au quotidien aux préoccupations des habitants. |
La décentralisation a bouleversé en profondeur
la répartition des compétences qui organise la vie quotidienne
des Français et donné aux élus locaux des responsabilités
considérables. Une dynamique de coopération doit s'installer
entre l'Etat, garant sur l'ensemble du territoire national de l'intérêt
général, et les collectivités locales confrontées
au quotidien aux préoccupations des habitants.
Mais cette coopération ne peut aboutir à un nouveau
désengagement de l'Etat et à une augmentation des charges
des communes. Il en est ainsi pour l'Education nationale qui doit
rester, sous tous ses aspects, de la seule responsabilité de
l'Etat, même au travers des contrats éducatifs locaux.
Le Mouvement des citoyens a défini trois axes
majeurs pour les politiques locales qu'il entend mener partout où
il sera en responsabilité : le développement économique
et la création d'emplois, la lutte contre les inégalités
et la qualité de vie.
Pour cela, le Mouvement des citoyens revendique dans
les négociations avec ses partenaires de la Gauche plurielle
une représentation dans les exécutifs intercommunaux,
communauté de communes, communautés d'agglomération,
communauté urbaine, structures majeures de la recomposition
et de l'aménagement du territoire national dans l'esprit de
la loi du12 juillet 1999.

|
|
Pour exploiter au maximum les conditions nouvelles favorables
de la croissance, il est essentiel que l'ensemble des acteurs locaux se
mobilisent autour de l'emploi et du développement économique. |
1- Créer les conditions du
développement
Agir au plan national et européen est nécessaire
mais reste insuffisant. Pour exploiter au maximum les conditions nouvelles
favorables de la croissance, il est essentiel que l'ensemble des acteurs
locaux, collectivités locales, chambres consulaires, tissu
industriel, organisations syndicales se mobilisent autour de l'emploi
et du développement économique.
La décentralisation qui a donné aux élus plus
de moyens, plus de libertés d'initiatives deviendrait un lourd
handicap s'ils continuaient à ne pas, sur ce point, prendre
la responsabilité qui est la leur. Car l'intervention des collectivités,
avec seulement 2 % de leur budget consacrés au développement
économique dont une faible part en direction du tissu industriel,
reste limitée.
Pour autant le développement économique ne doit pas
aboutir, à travers l'intervention économique des collectivités,
à l'exonération des impératifs de l'aménagement
du territoire, mais doit au contraire répondre aux exigences
des solidarités de l'espace telles qu'elles s'expriment dans
les contrats de plan Etat-régions.

|
|
La décentralisation mise en œuvre depuis
1982 dans un sens très libéral incite chaque collectivité
à agir seule, chacune allant à sa vitesse. Le résultat
est net. Globalement les communes riches se sont enrichis, les communes
pauvres appauvries. |
1.1. Un Etat républicain garant de la solidarité
nationale
La décentralisation mise en œuvre depuis
1982 dans un sens très libéral incite chaque collectivité
à agir seule, chacune allant à sa vitesse. Le résultat
est net. Globalement les communes riches se sont enrichis, les communes
pauvres appauvries, le territoire s'est fracturé, l'écart
de potentiel fiscal par habitant s'est accru entre les communes. De
grandes agglomérations d'un côté, la désertification
de l'autre ; Paris engorgé, des régions désertifiées
; à l'intérieur des agglomérations, des quartiers
résidentiels et des banlieues surpeuplées.
L'Etat républicain doit jouer pleinement son rôle de
garant de la solidarité nationale. Il n'est pas normal qu'en
France il y ait moins de péréquation qu'en Allemagne,
pays fédéral.
Pour cela les dotations aux communes et départements (DGF)
doivent être inversement proportionnelles à l'importance
des ressources fiscales des collectivités.
1.2. Favoriser l'intercommunalité
Mais avant tout il convient de mettre un terme aux rivalités
entre collectivités voisines pour attirer des emplois. La réponse
peut venir de l'intercommunalité qui permet de gérer
les espaces, les aides diverses et le retour en terme de fiscalité.
L'individualisme des communes est un frein, coûteux par surcroît,
à l'expansion. D'autant que l'accord local entre les communes
facilite le financement par le département, la région
et l'Etat de l'immobilier industriel qui est un élément
décisif du développement. Les Départements d'Outre-Mer
devraient, eux aussi, trouver dans cette démarche, un début
de réponse à leurs difficultés chroniques de
gestion dans ce domaine particulier.

|
|
La taxe professionnelle unique ne constitue pas seulement
un outil d'équité fiscale, elle permet également
d'améliorer l'efficacité économique de la gestion
publique. |
La loi sur le renforcement et la simplification de la
coopération intercommunale initiée par Jean-Pierre Chevènement
marque un tournant pour l'intercommunalité. L'encouragement
à la taxe professionnelle unique porté par la loi vise
à réduire localement les inégalités entre
les communes et les concurrences stériles. La taxe professionnelle
unique ne constitue pas seulement un outil d'équité
fiscale, elle permet également de rationaliser les choix d'aménagement,
d'organiser les services, de planifier les équipements et donc
d'améliorer l'efficacité économique de la gestion
publique.
Dans les agglomérations, l'objectif est de bâtir des
solidarités par la mise en commun des charges et des ressources
sur un projet s'attaquant aux problèmes de la ville. Il sera
possible de définir à une échelle pertinente
les politiques d'urbanisme, d'aménagement de l'espace et de
développement économique.
La nouvelle loi permet aussi de donner avec la communauté de
communes un avenir à nos communes rurales. L'étendue
de notre espace rural constitue une force et un facteur d'équilibre
pour notre pays, une source d'activités économiques
et agricoles qu'il faut continuer à soutenir et à développer.
Mais ces communes rurales n'ont généralement pas les
moyens financiers suffisants pour s'engager seules dans des projets
de développement structurants. A l'échelle de la communauté
de communes, la prise en charge de certains de ceux-ci devient possible
pour le bénéfice de toutes. En optant pour la taxe professionnelle
unique, outre l'encouragement que constituera une dotation globale
de fonctionnement améliorée, elles pourront donner de
concert une impulsion économique à leurs territoires
en favorisant l'implantation de petites et moyennes entreprises.

|
|
Le Mouvement des citoyens se prononce pour l'élection
au suffrage universel directs des conseils des structures intercommunales
à fiscalité propre. |
Par-delà l'instauration de la taxe professionnelle
unique qui, grâce au retour de taxe professionnelle, permettra
aux communes de financer les compétences qu'elles n'ont pas
transférées, de nombreuses mesures financières
incitatives prévues par la loi favoriseront la constitution
de structures intercommunales. Notamment l'intercommunalité
en zone urbaine ne pèsera plus sur les équilibres fragiles
de la dotation globale de fonctionnement qui sera autonome au moyen
d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat de 500 MF
par an sur cinq ans.
Le Mouvement des citoyens soutient donc la nécessité
de définir de véritables politiques de solidarité
qui ne peuvent que passer par l'intercommunalité renforcée.
Ce renforcement passe par le comblement du déficit démocratique
dont pâtissent les structures intercommunales. Le Mouvement
des citoyens se prononce pour l'élection au suffrage universel
directs des conseils des structures intercommunales à fiscalité
propre.

|
|
C'est au niveau du local en effet que les réseaux
de compétence peuvent se mettre en place de la façon la
plus efficace |
1.3. Départements d'Outre-Mer et taxe d'octroi
des mers
La taxe spécifique dite d'Octroi de Mer des DOM
est une survivance de l'époque coloniale. Sa modernisation,
devenue nécessaire par l'appartenance des DOM à l'Europe
par le Décret 99-1059 du 15 décembre 1999 est désormais
en voie d'être une réalité. Cette situation nouvelle
devrait avoir, très prochainement, pour conséquence
une utilisation mieux maîtrisée du produit de la Taxe
d'Octroi de Mer (recettes, répartition) au profit des communes.
Le Mouvement des citoyens veillera à l'application rapide de
cette nouvelle disposition.
1.4. Renforcer le partenariat entre l'Etat et les
collectivités
Tout au long de ces quinze dernières années,
les collectivités locales ont mis en place des procédures
qui ont permis de démontrer que dans le domaine du développement
économique leur apport pouvait être décisif. C'est
au niveau du local en effet que les réseaux de compétence
peuvent se mettre en place de la façon la plus efficace, pour
expertiser les projets, distinguer ceux qui sont les plus prometteurs
en terme de création d'emplois, mettre en place le soutien
le plus efficient.
Pour le Mouvement des citoyens, l'engagement des collectivités,
indispensable à la réussite de la politique engagée
au niveau national, nécessite l'instauration rapide d'un véritable
dialogue entre l'Etat et les élus locaux pour définir
à la fois les dispositions législatives efficaces et
cohérentes et les modalités d'un partenariat renforcé
entre l'Etat et les collectivités locales.

|
|
Créer l'emploi, c'est fréquemment au niveau
local créer des entreprises et donc favoriser l'émergence
d'entrepreneurs. Contrairement au discours libéral, cela ne passe
pas par une déréglementation du travail |
1.5. Favoriser la création d'entreprises
Créer l'emploi, c'est fréquemment au niveau
local créer des entreprises et donc favoriser l'émergence
d'entrepreneurs. Contrairement au discours libéral, cela ne
passe pas par une déréglementation du travail, mais
par la mise en place d'une capacité d'expertise et de soutien
des projets permettant autour du créateur d'entreprise la mobilisation
de tous les acteurs locaux. L'écoute attentive des attentes
de l'entrepreneur et sa mise en synergie avec les partenaires locaux
est tout autant importante, sinon plus, que l'apport d'une aide financière.
Cela suppose que se crée un véritable partenariat autour
de fonds locaux d'investissement, mais aussi de dispositifs de pépinières
d'entreprises, de parcs industriels locatifs, de centres de ressources
de transfert technologique, d'aide juridique aux candidats à
la création d'entreprises. Les exécutifs territoriaux
devront également respecter les délais de paiement en
direction des PME qui sont à la fois les grandes pourvoyeuses
d'emplois et les plus fragiles au niveau de leur trésorerie.
Cela suppose aussi de baisser les charges des petites entreprises
mais aussi de se donner les moyens de contrôler l'utilisation
des aides publiques. Ainsi doit-on laisser mettre en place des plans
de licenciements alors que l'entreprise réalise des profits
confortables ? Une loi obligeant en fonction des circonstances l'entreprise
à prendre en charge les licenciés jusqu'à leur
retraite ou leur réembauche freinerait les ardeurs mercantiles
et par la même le chômage. Sur le même ordre d'idée,
doit-on pratiquer le même impôt sur les bénéfices
d'une entreprise sans prendre en compte le nombre de salariés
qu'elle emploie ?

|
|
L'avenir sera aux pays sachant former leurs citoyens.
Le rôle des collectivités locales, dans ce domaine est déterminant
même si le cadre pédagogique doit être maintenu au
niveau national. |
1.6. Développer la formation et la recherche
La richesse d'un pays dépend avant tout de la
valeur ajoutée créée par ses entreprises, et
celle-ci est étroitement liée au niveau de qualification
de ses habitants, donc de leur formation. En effet, concernant l'innovation,
l'enjeu local est double : d'une part, constamment régénérer
l'actuel tissu industriel - " Il n'y a pas d'industries dépassées,
il n'y a que des technologies dépassées " - et,
parallèlement, favoriser l'éclosion de nouvelles industries
et de nouveaux services.
L'avenir sera donc aux pays sachant former leurs citoyens.
Le rôle des collectivités locales, dans ce domaine est
déterminant même si le cadre pédagogique doit
être maintenu au niveau national. Par l'aide matérielle
apportée dans l'accueil des enfants, dès leur plus jeune
âge (crèches, haltes-garderies, etc.), par les moyens
disponibles en direction de l'éveil des plus petits ou de la
formation des plus grands (dans le cadre scolaire ou dans les centres
de formation pour adultes), les collectivités locales ont un
rôle essentiel à jouer dans notre pays.

|
|
L'enjeu local se situe dans le combat au quotidien pour,
à partir des résultats des recherches lourdes portées
par les grandes entreprises et l'Etat, accompagner une évolution
constante de la recherche appliquée. |
80 % des produits qui seront vendus dans vingt ans n'existent
pas aujourd'hui. Un des enjeux majeurs pour l'emploi réside
donc dans la capacité de nos industries à être
présentes dans vingt ans sur ces nouveaux marchés.
L'enjeu local se situe dans le combat au quotidien pour, à
partir des résultats des recherches lourdes portées
par les grandes entreprises et l'Etat, développer de nouveaux
produits, de nouvelles techniques de fabrication, en résumé
accompagner une évolution constante de la recherche appliquée.
Cela passe en premier lieu par un renforcement et une réhabilitation
de l'enseignement technique dans les collèges et les lycées.
Cela passe aussi bien sûr par la mobilisation des IUT et des
écoles d'ingénieurs. En dégageant les moyens
financiers nécessaires, peut être créé
un espace de concertation entre les réseaux locaux PME/PMI
et les différents établissements de formation concernés.
L'intervention financière des collectivités locales
à cet égard est un élément indispensable
de la mise en place d'un développement fort de la recherche
appliquée, sans pour autant négliger la recherche fondamentale.
Mais, pour être conforme à l'esprit républicain,
elle doit rester encadrée par des dispositifs régulateurs
initiés par l'Etat, soucieux de gommer les fortes disparités
entre les territoires, et demeurer une compétence facultative.

|
|
être au service du public
respecter les droits des agents
|
1.7. Conforter et développer les services
publics, socle du maintien du lien social dans les communes
- Soutenir l'emploi dans les services publics :
Avec 1,4 millions de salariés dans la fonction publique, dont
30 000 titulaires embauchés chaque année, l'action
des collectivités dans le domaine de l'emploi commence d'abord
directement par sa fonction d'employeur public.
Cette fonction doit être assumée dans le respect des
principes du service public :
- être au service du public : la définition et l'étendue
du service public local, la qualité de l'accueil dans les services
municipaux sont les piliers d'une démocratie vivante ;
- respecter les droits des agents : si le statut de la fonction publique
territoriale doit savoir s'adapter, la substitution systématique
des agents statutaires par des agents à statut précaire
doit être révisée ; la négociation pour
la mise en place des 35 heures doit être encouragée ;
une politique ambitieuse de formation des agents doit être mise
en œuvre, ainsi qu'une revalorisation de certains emplois pour
éviter que les meilleurs cadres ne quittent la fonction publique.

|
|
La disparition ou l'inefficacité du service public
dans de larges secteurs géographiques est le résultat d'une
évolution, qui tend à vouloir aligner les critères
de gestion d'un service public sur ceux d'une entreprise |
- Répondre aux attentes des citoyens :
Les Français sont des millions à mesurer tous les jours
les conséquences néfastes du recul du service public
favorisé par la mise en place de la politique européenne
telle qu'elle a été définie par la conception
libérale héritée des traités de Maastricht
et d'Amsterdam. Les directives européennes visent à
remettre en cause les entreprises du service public. Ces dernières
(France Télécom, La Poste, EDF-GDF, SNCF, Air France,
etc.) sont, au contraire, un atout pour l'Etat républicain
et ne sont aucunement un handicap pour des coopérations ou
des alliances européennes. La disparition ou l'inefficacité
du service public dans de larges secteurs géographiques est
le résultat d'une évolution, qui tend à vouloir
aligner les critères de gestion d'un service public sur ceux
d'une entreprise, dont la périphérie des agglomérations
et les communes rurales sont les premières victimes.
Dans les quartiers périphériques des agglomérations,
dont le développement récent ne s'est pas toujours accompagné
d'une présence adaptée des services publics, dans les
communes rurales dans lesquelles la course à la rentabilité
des services publics s'est traduite par une disparition progressive
de la plupart d'entre eux, les élus locaux constataient jusqu'à
présent la dégradation des services offerts aux habitants
de leur commune.

|
|
Avec les emplois-jeunes de nouveaux métiers apparaissent
et permettent aux élus locaux de répondre aussi aux nouvelles
demandes de leurs administrés. |
Le plan Aubry en faveur de l'emploi des jeunes a été
une première mesure pour inverser cette évolution. Il
permet de transformer des dépenses passives en dépenses
actives, de donner aux jeunes une réelle chance de s'insérer,
de redonner l'espoir à tous ceux qui nous entourent et de favoriser
ainsi un développement de la demande de produits et services.
En lien avec l'Etat, il offre la possibilité aux collectivités
d'adapter les services publics locaux aux attentes des habitants.
Que ce soit en matière de sécurité dans les quartiers
avec les emplois de médiateurs sociaux, d'agents de prévention,
d'agents d'ambiance, que ce soit en matière de prévention
et d'éducation avec les coordonnateurs de soutien scolaire
et les aides éducateurs, que ce soit en matière d'amélioration
de l'environnement avec les emplois d'agents d'entretien des espaces
naturels ou d'agents de traitement des déchets industriels
et urbains de nouveaux métiers apparaissent et permettent aux
élus locaux de répondre aussi aux nouvelles demandes
de leurs administrés.
Mais ces emplois-jeunes, s'ils ont permis d'inverser une évolution
néfaste, ne doivent pas devenir le cheval de Troie de la précarité
généralisée au sein des services publics. Cette
politique d'emplois-jeunes implique une véritable formation
qualifiante qui seule peut permettre une réelle insertion.
Si les emplois-jeunes ou les emplois précaires existants auparavant
répondent à un vrai besoin de la population, ils doivent
devenir des emplois permanents et reconnus comme tels. La pérennité
de leur financement doit être assurée.

|
|
La lutte contre les inégalités ne se justifie
pas seulement par l'aide apportée à ceux qui souffrent,
elle concourt au dynamisme et à l'équilibre de la société
française dans sa totalité. |
2 - Lutter contre les inégalités
Chaque citoyen, dans une République vivante,
est une richesse irremplaçable. Que la pauvreté, la
maladie, le handicap en frappe un seul et l'empêche d'exercer
pleinement sa citoyenneté, et c'est l'ensemble du modèle
républicain qui est touché. La lutte contre les inégalités
ne se justifie donc pas seulement par l'aide apportée à
ceux qui souffrent, elle concourt au dynamisme et à l'équilibre
de la société française dans sa totalité.
Les mutations profondes qu'a connues notre société
ont pour conséquence une croissance de l'individualisme et
la rupture de certains cercles de solidarité : solidarité
avec les exclus de l'économie, solidarité entre les
générations, solidarités familiales. Cette notion
de solidarité doit être remise en avant par des actions
de fond.

|
|
Le Mouvement des citoyens entend développer de
nouvelles politiques centrées sur la lutte contre les incivilités
(médiateurs sociaux, agents d'ambiance, agents d'entretien, etc.)
que le plan emploi-jeune permet. |
2.1. Lutter contre l'insécurité
L'insécurité frappe d'abord les plus modestes,
ceux qui ne peuvent trouver les moyens de vivre dans un quartier plus
calme. A force de dégradations quotidiennes, de tapages nocturnes
répétés, de rapports conflictuels, d'insultes
ou même seulement de moqueries régulières, de
mauvais fonctionnements des services publics, les habitants des quartiers
populaires considèrent qu'ils ne sont plus respectés.
Ils estiment que le milieu dans lequel ils vivent échappe à
la maîtrise collective.
Il n'y a pas de véritable solution sans l'engagement de tous
: l'Etat bien sûr, maillon indispensable dans une lutte efficace
contre l'insécurité, mais aussi les collectivités
locales, les associations, les organismes sociaux, les professionnels
de l'animation et du travail social, les commerçants et les
milieux économiques. Les maires et les conseillers généraux
(dont la prévention est une des missions essentielles) peuvent
être les initiateurs de commissions locales de sécurité,
organes d'échanges, d'informations et d'action, réunissant
tous les partenaires présents dans une collectivité.
Ces commissions doivent servir à une meilleure connaissance
des phénomènes liés à l'insécurité
et à déterminer des stratégies communes.
Dans tous les domaines touchant à la sécurité,
la prévention doit être privilégiée. Le
Mouvement des citoyens entend poursuivre la politique de la ville
(réhabilitation des logements et des quartiers, réactivation
des services publics, développement des activités économiques
dans les quartiers, etc.), mais aussi développer de nouvelles
politiques centrées sur la lutte contre les incivilités
(médiateurs sociaux, agents d'ambiance, agents d'entretien,
etc.) que le plan emploi-jeune permet. Les contrats locaux de sécurité
instaurés par Jean-Pierre Chevènement offriront le cadre
qui permettra à ces dispositions d'atteindre leur pleine efficacité.
Il serait préférable en outre que les contrats locaux
de sécurité soient harmonisés avec les contrats
de ville.

|
|
Il n'est pas admissible que certains élus refusent
systématiquement de construire du logement social sur leur commune
et ajoutent par leurs égoïsmes la ségrégation
spatiale à la ségrégation sociale. |
2.2. Agir mieux pour le logement
Depuis la fin de la période des trente glorieuses,
le nombre des sans-logis et des mal logés n'a cessé
de s'accroître. De même, le mal vivre et l'insécurité
n'ont cessé de s'installer dans les grands ensembles d'habitat
social. Malgré les efforts importants du gouvernement, notamment
le volet logement de la loi contre les exclusions, le chantier reste
grand pour répondre aux besoins en logements, tant quantitativement
que qualitativement.
Si la politique du logement, pour échapper à la libéralisation
de son marché, doit être conduite par l'Etat, en particulier
bien sûr pour le segment social, la réussite sur le terrain
requiert une implication accrue des collectivités locales.
Cela passe par une politique volontariste pour acquérir des
logements destinés à l'habitat social, l'aménagement
d'hôtels sociaux, une politique urbaine de revalorisation des
quartiers d'habitat social, une politique de mixité sociale
à l'intérieur des quartiers et entre les quartiers et
les villes à l'échelle de l'agglomération.
Sur ce dernier point, il n'est pas admissible que certains élus
refusent systématiquement de construire du logement social
sur leur commune et ajoutent par leurs égoïsmes la ségrégation
spatiale à la ségrégation sociale. Des mesures
contraignantes devront impérativement être prises pour
remédier à cette inégalité, notamment
par l'application des sanctions financières prévues
par la loi, pour éviter la pérennisation des ghettos.

|
|
Il convient de réformer en profondeur les impôts
locaux, afin qu'ils ne pénalisent pas les foyers les plus modestes. |
Pour réussir une politique de l'habitat solidaire
et cohérente, il sera nécessaire de s'appuyer sur les
nouveaux outils de l'intercommunalité, une solidarité
financière renforcée, une nouvelle génération
des contrats de ville, une réactivation des plans locaux de
l'habitat pour une gestion raisonnée à l'échelle
des agglomérations.
Enfin l'accès au logement dans le monde d'aujourd'hui doit
se comprendre au sens large du terme, c'est à dire le droit
à un toit, au chauffage, à l'éclairage et à
l'eau. Dans ce cadre, le MDC préconise l'abaissement du taux
de TVA de l'électricité et de l'eau.
2.3. Réformer les impôts locaux
Pour assurer la réalisation des divers projets,
l'impôt est nécessaire. C'est un acte citoyen par le
choix contrôlé de l'affectation de son produit et un
acte de solidarité par l'établissement de son assiette.
Les impôts directs locaux sont assis sur les valeurs locatives
des propriétés bâties ou non bâties dont
la dernière révision de l'estimation par l'administration
centrale remonte à 1961 pour les propriétés non
bâties et à 1970 pour les propriétés bâties.
Il en résulte des écarts importants entre la valeur
cadastrale servant au calcul de l'impôt et la réalité
de la situation.
Cette absence de prise en compte de l'évolution de l'espace
urbain crée des inégalités entre collectivités
locales - certaines ont vu leur espace considérablement prendre
de la valeur pendant que d'autres au contraire se sont dévalorisées
- et entre contribuables. On vérifie souvent des montants de
taxes d'habitation bien supérieurs dans les quartiers HLM à
ceux enregistrés dans certains quartiers résidentiels
d'une même ville. Il convient de réformer en profondeur
les impôts locaux, afin qu'ils ne pénalisent en priorité
les foyers les plus modestes.

|
|
Des outils innovants, comme le Revenu Minimum Etudiant
(RME), doivent être inventés et développés. |
2.4. Se battre pour l'accès de tous à
une pleine citoyenneté
Depuis vingt-cinq ans, la panne de l'ascenseur social,
la crise du modèle républicain, égalitaire et
citoyen, la montée des communautarismes, la fracture sociale,
entraînent notre République à la dérive.
Vouloir y mettre un terme, c'est accepter de mener un combat politique
pour faire revivre notre projet républicain de société.
Les jeunes des quartiers populaires sont ceux qui sont le plus touchés
et parmi eux ceux issus de l'immigration. Tous ces jeunes sont en
droit d'attendre de la République qu'elle impose à tous
le respect de ses principes : l'égalité de traitement,
l'interdiction de toute discrimination ethnique, religieuse, culturelle,
spatiale. En retour, la République ne saurait admettre le non-respect
des règles élémentaires de civilité.
Les collectivités locales ont un rôle essentiel pour
contribuer à l'accès de tous à une pleine citoyenneté.
L'effort doit notamment s'exercer par une lutte sans relâche
contre les discriminations partout où elles existent : d'abord
dans l'éducation en faisant vivre l'école de la République,
mais également en matière d'accès à la
formation, à l'emploi, au logement, à la culture, aux
loisirs. Des outils innovants, comme le Revenu Minimum Etudiant (RME),
doivent être inventés et développés.
Pour que la République ne soit pas un vain mot, il faut que
nos administrations soient à l'image de ceux qui vivent dans
nos villes et départements d'aujourd'hui. Les collectivités
locales devront intégrer en leur sein ces jeunes encore trop
souvent au bord du chemin, en leur donnant les responsabilités
auxquelles ils aspirent légitimement, dans le cadre des dispositions
réglementaires.

|
|
Si le cadre pédagogique doit être maintenu
au niveau national, il reste que les politiques locales ont un rôle
déterminant à jouer en complément de l'Education
nationale. |
2.5. Soutenir l'école et aménager le
temps périscolaire
C'est l'école républicaine et laïque
qui vise à former et intégrer les citoyens de demain.
Elle reste, pour tous, la meilleure chance. Les parents ne s'y trompent
pas puisqu'ils attendent, pour leurs enfants, beaucoup d'elle. L'école
doit donc devenir la priorité de toutes les collectivités
comme de l'Etat. Les élus locaux s'en donneront les moyens
et agiront, avec les enseignants et parents si nécessaire,
pour que l'Etat assume parallèlement toutes ses responsabilités
en adaptant le nombre d'élèves par classe.
Si le cadre pédagogique doit être maintenu au niveau
national, il reste que les politiques locales ont un rôle déterminant
à jouer en complément de l'Education nationale. Il s'agit
d'offrir aux écoles et collèges un cadre matériel
sûr et adapté, et d'apporter un soutien financier sur
des projets spécifiques.
Mais cela n'est pas suffisant, le temps de l'enfant aujourd'hui comporte
une partie périscolaire essentielle. Ce temps spécifique
doit être clairement différencié du temps scolaire,
le négliger serait une erreur. Dans la lutte contre les inégalités,
aucun effort n'est vain et les projets périscolaires ont pour
caractéristique de s'adresser à tous, sans aucune discrimination
sociale. Il est du ressort des collectivités locales d'aider
ces projets à se construire.

|
|
Cela suppose qu'en accompagnement d'un soutien des revenus,
une politique active soit menée pour garantir les droits fondamentaux
que sont le logement et la santé, les deux conditions d'une insertion
réussie dans la société. |
2.6. Soutenir les politiques d'insertion
Une des premières inégalités vécues
par les Français est celle du chômage, non seulement
des jeunes mais aussi des salariés qui, âgés de
plus de 45 ans et ayant perdu leur emploi suite à un licenciement,
se trouvent très souvent exclus du monde du travail. Paradoxe,
leur expérience professionnelle devient un frein à l'embauche.
On ne peut pas oublier non plus que les femmes sont, dans des proportions
dramatiques, plus encore victimes du chômage que les hommes
et que malgré la loi, à travail égal, elles se
trouvent moins bien payées. Il n'y aura pas de véritable
démocratie tant que les femmes ne seront que des citoyennes
de seconde zone, en prise à des difficultés pour s'assumer
financièrement. On ne peut négliger non plus le fait
que les femmes et les jeunes filles issues de l'immigration se trouvent
plus encore que les femmes et les jeunes filles d'origine française
en difficulté pour avoir un travail et justifier leur indépendance
personnelle.
La véritable solution repose évidemment
dans le combat mené pour l'emploi. Mais celui-ci, parce que
long et difficile, doit être accompagné par l'exercice
de la solidarité pour donner pleinement son droit à
l'insertion. Car l'insertion fonctionne. Pour l'essentiel, les gens
qui vivent des périodes de très grandes difficultés
s'en sortent s'ils sont aidés et s'insèrent dans la
société. Cela suppose qu'en accompagnement d'un soutien
des revenus, une politique active soit menée pour garantir
les droits fondamentaux que sont le logement et la santé, les
deux conditions d'une insertion réussie dans la société.
Dans la réalité, la solidarité matérielle
est à elle seule insuffisante à vaincre l'exclusion,
et ne constitue qu'une forme évoluée et organisée
de charité. Assurer l'accès égalitaire à
la santé va déjà plus loin, puisqu'il vise à
instaurer une capacité normale. Le terme santé doit
être compris dans un sens large, au-delà de la CMU. La
souffrance morale et l'affaiblissement psychique associés à
l'exclusion appellent aussi des formes d'assistance spécifiques
pour assurer une insertion sociale durable. Des formes nouvelles d'action
sociale sont à développer, en priorité dans les
grandes villes.

|
|
L'intervention des collectivités locales en faveur
des personnes âgées s'inscrit dans le cadre du maintien du
système de retraite et de l'abandon des funestes projets de fonds
de pension, créateurs d'inégalités. |
2.7. Maintenir la solidarité avec les personnes
âgées
L'intervention des collectivités locales en faveur
des personnes âgées s'inscrit dans le cadre du maintien
du système de retraite et de l'abandon des funestes projets
de fonds de pension, créateurs d'inégalités.
L'allongement de la durée de la vie conduit à mettre
en place des politiques novatrices et audacieuses en direction des
personnes âgées. Près d'un million d'entre elles
sont aujourd'hui tellement handicapées par l'âge qu'elles
sont dans une situation de dépendance et d'isolement qui légitime
un immense effort de solidarité.
Le maintien à domicile, est souvent la solution la plus satisfaisante
humainement. Des aides doivent être prévues pour l'aménagement
des logements, l'organisation de transports adaptés, des livraisons
à domicile de courses, de repas, de livres, etc.
Mais parallèlement, les collectivités auront à
poursuivre l'humanisation des maisons de retraite qui seront dans
l'obligation d'accueillir sans cesse un nombre croissant de personnes
âgées en condition de grande dépendance. Devront
aussi être imaginées des formules nouvelles pour accueillir
également, plus que cela n'est fait actuellement, des personnes
valides et semi-valides, en favorisant la mixité sociale et
générationnelle.
Par ailleurs, les inégalités criantes en matière
de barèmes d'attribution de la Prestation Spécifique
Dépendance (PSD) par les conseils généraux devront
être gommées. Une étude globale est à mener
à ce sujet afin d'unifier, autant que faire se peut, les conditions
d'accès et de rémunération de cette prestation.

|
|
Les collectivités locales pourront participer
utilement aux efforts de solidarité en direction des pays du sud. |
2.8. Renforcer le rôle des collectivités
locales dans la coopération internationale
Les communes font partie du vaste ensemble que constitue
la communauté nationale et internationale. La mise en place
d'une politique de jumelage et d'échanges entre villes françaises
et étrangères, par exemple dans le cadre d'un codéveloppement
avec les pays du sud ne pourra que favoriser la connaissance de l'autre,
l'esprit de tolérance et de solidarité qui sont des
valeurs fondamentales de notre mouvement.
Les collectivités locales pourront participer utilement aux
efforts de solidarité en direction des pays du sud. Il conviendra
de développer le partenariat entre des communes, des groupements
de communes, des départements ou des régions françaises,
et des collectivités locales de ces pays, sur la base de projets
clairement définis répondant aux besoins concrets de
la population (dispensaires, écoles, équipements hydrauliques,
assistance technique etc.). Un tel partenariat, source d'enrichissement
mutuel, contribue au développement économique des pays
et à la stabilisation des populations sur place.

|
|
La culture est un enjeu majeur de la République.
Il convient d'en développer la proximité en ouvrant son
accès |
2.9. Développer la politique culturelle
La culture est un enjeu majeur de la République.
Il convient d'en développer la proximité en ouvrant
son accès, d'une part grâce aux choix retenus en matière
de politique culturelle, d'autre part aux moyens alloués à
la culture. Ce développement requiert trois conditions :
- une meilleure articulation des actions de l'Etat et des collectivités
territoriales, et la redéfinition claire des compétences
respectives de l'un et des autres ;
- l'intensification de partenariats, particulièrement entre
collectivités, et la réflexion sur les stratégies
à mener face aux nouveaux enjeux et dangers : urbanisation,
transformation des territoires, mobilité des personnes et des
savoirs, complexification et éloignement des centres de décision,
développement et montée des communautarismes ;
- une réflexion sur les emplois nouveaux du secteur culturel.

|
|
Il faut dans les grandes agglomérations développer
des alternatives véritables à l'automobile, en s'appuyant
sur les transports en commun et les pistes cyclables notamment, mais aussi
sur la voiture électrique et au gaz. |
3 - Améliorer la qualité
du cadre de vie
3.1. Concilier développement et qualité
de vie
Opposer développement et qualité de vie
résulte pour certains d'un fantasme de peur du progrès.
Pourtant depuis des siècles, la presque totalité des
paysages français ont été façonnés
par le travail de l'homme. La recherche de l'intérêt
général n'est pas opposable à la préservation
nécessaire de notre environnement, car elle s'inscrit aussi
dans le long terme et suppose la solidarité ainsi que la responsabilité
à l'égard des futures générations.
Des efforts supplémentaires devront permettre
une nouvelle politique des transports. D'évidence, il faut
dans les grandes agglomérations développer des alternatives
véritables à l'automobile, en s'appuyant sur les transports
en commun et les pistes cyclables notamment, mais aussi sur la voiture
électrique et au gaz. Le Mouvement des citoyens veillera également
à définir une politique d'urbanisme différente
rapprochant le lieu du travail de celui du domicile et adaptée
aux nouveaux modes de vie.
Rétablir du bien-être dans des quartiers d'habitat social
qui en sont dépourvus depuis des années, passe par une
requalification en profondeur de ces morceaux de ville, avec des moyens
financiers très importants que nécessitent les réhabilitations,
le réaménagement des espaces extérieurs, la réfection
des voiries, mais aussi la démolition-reconstruction et la
réalisation d'un habitat plus diversifié et plus équilibré,
faisant échec à la ghettoïsation de certains quartiers.

|
|
le Mouvement des citoyens propose la nationalisation
de la distribution et de la gestion de l'eau. |
Le secteur rural doit faire l'objet d'une attention
particulière compte tenu de sa fragilité économique
et de celle des équilibres naturels. La politique d'aménagement
du territoire doit combattre la tendance naturelle actuelle à
accentuer les écarts entre secteurs géographiques riches
et secteurs géographiques pauvres. Favoriser le développement
économique des zones rurales doit être une préoccupation
constante, grâce à une véritable politique agricole
durable, aux aides à l'installation de petites et moyennes
entreprises, au développement maîtrisé du tourisme
et des activités de loisirs… Des mesures agro-environnementales,
la restauration des rivières, une politique de l'eau, sont
indispensables pour préserver les équilibres naturels.
De même le relèvement, l'entretien et la vitalité
du patrimoine des communes est un aspect de la politique culturelle
et artistique des collectivités, absolument fondamental pour
le bien-vivre de nos contemporains.
Chacun commence à prendre la mesure de la rareté
de l'eau et de l'importance primordiale que représente la protection
de cette ressource. Les énormes dégâts provoqués
par les inondations dans le sud de la France et leur important coût
financier prouvent combien ce problème est crucial. Les investissements
nécessaires, leur coût, leur financement, pose la question
de la privatisation au profit de grands groupes de la distribution
de l'eau.
Ces grands groupes, qui ne sont soumis à quasi aucune concurrence,
et leurs actionnaires se sont enrichis des fruits de la corruption
et de la contribution des consommateurs. Pour lutter contre ces abus
inacceptables, le Mouvement des citoyens propose la nationalisation
de la distribution et de la gestion de l'eau.

|
|
En matière de loisirs, seront privilégiées
les actions concernant le plus grand nombre, par la multiplication des
équipements de proximité. |
3.2. Offrir des services à la population
L'amélioration de la qualité de vie ne
se limite pas à la protection des espaces naturels. Elle passe
aussi par une offre de services correspondant aux attentes des habitants.
L'évolution de la société, dont une des conséquences
positives est l'égal accès au travail des femmes et
des hommes, oblige à revoir et élargir les modes de
garde des enfants. Dans un souci de renforcement du service public
en la matière, il faut développer les structures d'accueil
qui devront être pour chaque enfant des lieux d'épanouissement
et d'éducation. Ces services seront mis en place en veillant
à ne pas engendrer d'effet pervers sur la cellule familiale
qui reste le premier niveau d'apprentissage du vivre ensemble.
En matière de loisirs, seront privilégiées les
actions concernant le plus grand nombre, par la multiplication des
équipements de proximité, en particulier dans les quartiers
défavorisés (stades, équipements sportifs de
quartier, médiathèques, ludothèques, etc.). S'il
est admis que l'élite dans un domaine sportif ou culturel tire
la masse vers le haut, les pratiques de masse devront néanmoins
bénéficier de l'essentiel de l'effort consenti par les
collectivités locales.
La préoccupation des élus du Mouvement des citoyens
est celle d'un libre accès à tous ces services. Une
politique tarifaire devra donc être adaptée aux revenus,
afin de favoriser une fonction redistributive.

|
|
Les projets seront construits en commun ou ne seront
pas. Le seul moyen d'atteindre cet objectif repose sur la politique. |
Conclusion
La mise en place de politiques locales ambitieuses reposera
avant tout sur le travail d'équipes compétentes et unies,
utilisant les connaissances acquises antérieurement dans des
actions collectives de terrain. Ces équipes, représentatives
de la population, devront veiller à leur futur renouvellement
en favorisant l'émergence sur le terrain d'un débat permanent
et en suscitant l'intérêt de tous à la vie publique.
Le modèle républicain propose de dépasser
les intérêts particuliers portés par chacun pour
atteindre l'intérêt général qui répondra
aux attentes de la société. L'élu fait partie de
ce processus démocratique. Le dialogue et l'élaboration
collective d'un projet, catalysé par l'élu, est un modèle
à proposer à tous ceux qui pensent que la seule règle
est celle de la jungle, du chacun pour soi. Il faut expliquer à
tous, en particulier aux jeunes qui sont l'avenir de notre pays, que
l'individualisme poussé à l'extrême, c'est-à-dire
exercé en dehors de toute norme collective, ne peut les conduire
que dans une impasse.
Les projets seront construits en commun ou ne seront pas. Le seul moyen
d'atteindre cet objectif repose sur la politique.
La concertation permanente, l'écoute et le dialogue
seront à la base des politiques locales. Les hommes et les femmes
qui conduiront ces politiques devront concilier l'intérêt
général et les intérêts particuliers, expliquer
le bien fondé de l'action menée.
Les politiques locales doivent être faites par les citoyens, pour
les citoyens.
|