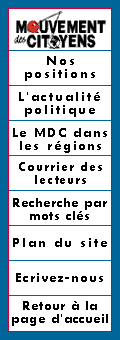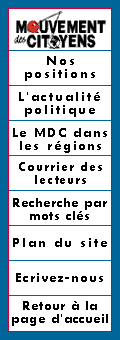|
La société de plein emploi constitue plus
que jamais un objectif légitime, sous réserve qu'il s'agisse
d'emplois au plein sens du terme |
II Depuis les dernières élections municipales
de 1995, le contexte économique a évolué. La
reprise de la croissance semble vouloir s'inscrire dans la durée
en France et en Europe où elle pourrait atteindre les 3 % ces
prochaines années. En même temps, la baisse du chômage,
en recul depuis 1997, devrait se poursuivre, tant au plan européen
que français où l'on constate le retour symbolique en
dessous de la barre des 3 000 000 de chômeurs. La société
de plein emploi que le Mouvement des citoyens a toujours défendue,
pendant que d'autres se contentaient d'une gestion passive du chômage
considéré comme élément structurant de
notre économie, constitue plus que jamais un objectif légitime,
sous réserve qu'il s'agisse d'emplois au plein sens du terme
et non de la précarisation d'une partie de la société
active.

|
|
il appartient au politique d'orienter les fruits de
la croissance pour un usage au service du plus grand nombre |
Car la reprise de la croissance ne doit pas être
considérée comme une fin en soi, mais comme un outil
de la justice sociale. Que vaut le progrès économique
sans le progrès social ? Aborder l'économie sans dimension
sociale n'a aucun sens. L'apparition des travailleurs pauvres, aux
conditions de vie fragilisées par le temps partiel et les emplois
à statut précaire, ne peut nous satisfaire. Toutes les
statistiques confirment que le travail ne protège plus de la
pauvreté, pas plus que le chômage ne suffit à
expliquer l'exclusion. De même l'augmentation des familles dépendantes
des prestations sociales dans une société qui produit
de plus en plus de richesses est bien la démonstration qu'il
appartient au politique d'orienter les fruits de la croissance pour
un usage au service du plus grand nombre.
Pour cela le politique doit prendre conscience de ses
responsabilités. Beaucoup de Français l'ont compris,
eux qui s'inquiètent des menaces que fait peser sur la démocratie
la mondialisation néolibérale. En rejetant l'idée
d'une dictature des marchés financiers contre laquelle il n'y
aurait rien à faire, les citoyens attendent des gouvernements
qu'ils puissent peser sur la mondialisation, même s'il incombe
aussi aux citoyens de s'investir dans les syndicats et les associations
à vocation civique (consommation, cadre de vie, ONG, etc.).

|
|
pour réussir le changement, la gauche a besoin
de débattre en dehors des dogmes et des vérités imposées |
La gauche, au gouvernement depuis juin 1997, a la capacité
d'apporter à la politique économique et sociale les
changements nécessaires. Chacun sait à gauche que l'ambition
de dégager les possibilités réelles d'action
que la situation actuelle permet et apprécier le sens et la
portée des engagements pris devant les électeurs ne
peut être l'affaire d'un seul parti et encore moins d'un seul
homme. Le calendrier politique est chargé puisqu'il verra se
succéder en l'espace d'une année pas moins de quatre
élections : celles municipales et cantonales en 2001, puis
les élections législatives et présidentielles
en 2002. Ces échéances électorales, sous réserve
d'être gagnées, sont autant d'occasions pour la gauche
d'inscrire son action dans la durée et à tous les échelons
territoriaux. Pour cela, elle doit se présenter telle qu'elle
a su le faire pour l'emporter, c'est-à-dire plurielle. Ne pas
tenir compte de cette réalité équivaudrait à
se condamner à un échec qui serait celui de toute la
gauche.
De la composition de listes ouvertes aux représentants
de toutes les forces reconnaissant au politique la prééminence
sur le marché et refusant le libéralisme dépend
la réussite du débat proposé aux citoyens, débat
nécessaire pour fixer les politiques de progrès au service
de tous à mettre en place. La responsabilité de la gauche
est d'autant plus grande que la droite doit faire face à son
incapacité à proposer un projet cohérent, tant
elle est prise dans les mailles de ses contradictions et oppositions
internes. Qui peut bien dire à ce jour quelle sera la ligne
directrice de la droite lors des prochaines élections ?
Dans le débat, le Mouvement des citoyens entend
bien faire entendre sa différence et apporter à l'ensemble
de la gauche sa liberté de pensée, au service de la
nécessaire refondation républicaine et de la justice
sociale. Car pour réussir le changement, la gauche a besoin
de débattre en dehors des dogmes et des vérités
imposées.

|
|
Deux thèmes seront au cœur des débats :
la rénovation de la démocratie et la définition de
politiques publiques locales qui participent à l'objectif de progrès
social. |
III Deux thèmes seront au cœur des débats
que le Mouvement des citoyens proposera dans le cadre des élections
cantonales et municipales de 2001 : la rénovation de la démocratie
et la définition de politiques publiques locales qui participent
à l'objectif de progrès social.
La rénovation de la démocratie ne peut
évidemment pas être restreinte à la seule dimension
locale. Dans un monde où les implications des décisions
internationales sur le local sont de plus en plus oppressantes, l'action
politique doit retrouver l'estime qu'au cours de ces dernières
années les citoyens lui avaient retirée. Pour cela la
confiance entre les citoyens et leurs représentants doit être
restaurée et l'association des habitants à la définition
des politiques accentuée. Notre texte des Ulis, préparatoire
aux élections départementales et régionales de
1998, avait déjà inscrit des propositions qui sont aujourd'hui
au cœur du débat politique dans notre pays, qu'il s'agisse
d'un plus grand accès des femmes aux fonctions électives,
d'une lutte résolue contre le cumul des mandats, d'une démocratisation
du fonctionnement des pouvoirs locaux, mais aussi d'une transparence
accrue du fonctionnement des collectivités locales.
La définition de nos politiques locales s'articule
autour de trois axes majeurs au premier rang desquels figure notre
volonté d'établir au plan local les conditions d'un
développement économique, porteur d'emplois. Le second
axe de nos politiques doit être l'action de solidarité
envers les personnes victimes des politiques libérales. Enfin
le troisième volet doit permettre de concilier le développement
et la qualité du cadre de vie, par une politique de l'environnement
mais aussi un souci permanent de l'épanouissement des citoyens
à travers une offre de services collectifs.

|
|
La mondialisation a, entre autres conséquences,
celle d'éloigner de plus en plus les centres de décision
du citoyen |
I - Rénover la démocratie
Les conséquences de la mondialisation libérale
sont en complète contradiction avec le projet républicain
que le Mouvement des citoyens défend. La mondialisation a,
entre autres conséquences, celle d'éloigner de plus
en plus les centres de décision du citoyen, dans le domaine
de l'entreprise privée, mais aussi dans la sphère des
instances publiques, à l'image de la commission européenne,
de l'OCDE ou de l'OMC. Les pouvoirs du peuple sont confisqués
régulièrement par des instances non élues qui
s'exonèrent de rendre des comptes à la nation alors
que leurs décisions peuvent présenter un fort impact
social, notamment en matière d'emplois, et rester cependant
sans possibilité de recours. La France a besoin d'une démocratie
revivifiée où les citoyennes et les citoyens se sentent
partie prenante. Cette exigence demande de la part de tous, à
commencer par les élus et les responsables politiques, rigueur,
honnêteté, intégrité. Les élections
locales sont pour le Mouvement des citoyens l'occasion d'être
innovateur dans ce domaine.

|
|
Il appartient à l'élu politique de faire
de la participation des habitants le préalable indispensable à
l'action politique, en organisant l'écoute et l'expression du citoyen,
en le rendant partie prenante de chacune des décisions qui le concernent. |
1 - Favoriser l'expression des citoyens
dans les politiques locales
Les " affaires " et le taux d'abstention ne
sont que les révélateurs d'une crise profonde de la
démocratie. Celle-ci ne sera combattue que si nous réussissons
à renouveler la façon d'aborder l'action politique.
Cela passe nécessairement par une plus grande implication des
habitants aux décisions qui les concernent. C'est pourquoi
les collectivités devront dégager des moyens (notamment
en terme de campagne d'information) pour favoriser et inciter à
l'inscription sur les listes électorales et au vote.
1.1. Garder des liens étroits entre élus
et citoyens
Une majorité des citoyens ont le sentiment que
leurs élus sont éloignés des préoccupations
qu'ils peuvent avoir ou plus grave encore du quotidien qui est le
leur. Si cette critique peut s'avérer parfois exacte, encore
faut-il reconnaître que ce sentiment d'incompréhension
peut également être vécu par les élus vis-à-vis
de leur responsabilité et de leur travail.
La superposition des compétences liées à la décentralisation
et la complexité des dossiers à traiter par les collectivités
locales amènent ces dernières à s'entourer d'une
administration à caractère technique. Le risque est
grand de voir se diluer le projet politique porté par les élus
dans une technostructure administrative et des procédures que
l'on souhaiterait plus simples pour davantage d'efficience.
Pour contrecarrer cette dérive, il appartient aux élus
de garder des liens étroits avec leurs électeurs et
d'être pédagogues pour expliquer le fonctionnement de
leur collectivité et les projets politiques mis en œuvre.
Il appartient à l'élu politique de faire de la participation
des habitants le préalable indispensable à l'action
politique, en organisant l'écoute et l'expression du citoyen,
en le rendant partie prenante de chacune des décisions qui
le concernent.

|
|
Toute initiative de concertation décentralisée
du type comités de quartier dotés de moyens de fonctionner,
réunion publique d'information sur la politique municipale, etc.,
doit être favorisée |
1.2. Favoriser la concertation
Renouer le contact avec les citoyens, mieux prendre
en compte leurs préoccupations, ne peut se réaliser
que dans un cadre qui permet la recherche de l'intérêt
général et qui évite la défense des intérêts
particuliers.
Toute initiative de concertation décentralisée
du type comités de quartier dotés de moyens de fonctionner,
réunion publique d'information sur la politique municipale,
etc., doit être favorisée de même que la mise en
place d'instances de consultation de résidents étrangers
afin de faciliter l'intégration républicaine. Ces formes
de consultation peuvent favoriser des échanges fructueux aussi
bien pour les habitants que pour les élus : s'ils ne peuvent
être un lieu de décision, les conseils de quartier sont
un lieu où les habitants viennent signaler les problèmes
de la vie quotidienne et faire des propositions sur l'animation de
leur quartier. Ils seront dès lors un élément
fort du débat entre élus pour que l'action municipale
ne soit pas déconnectée des réalités.

|
|
le Mouvement des citoyens a toujours préféré
proposer aux étrangers résidant durablement en France, non
un droit de vote réservé uniquement pour les scrutins locaux,
mais de devenir des citoyens à part entière |
1.3. Mener la réflexion sur le droit de vote
aux étrangers
La France républicaine ne distingue pas, pour
les accueillir, la religion de ses citoyens, pas plus que leur origine.
Dès lors qu'ils entendent partager le destin de la nation,
tous ont vocation à devenir à part entière des
citoyens de la République française. C'est pourquoi,
le Mouvement des citoyens a toujours préféré
proposer aux étrangers résidant durablement en France,
non un droit de vote réservé uniquement pour les scrutins
locaux, mais de devenir des citoyens à part entière
et d'acquérir avec la nationalité un droit de vote complet
et non amputé. Cela suppose de faciliter l'accès à
la nationalité française, notamment en réduisant
la durée de résidence obligatoire, et en simplifiant
les démarches administratives préalables à la
naturalisation.
Cependant, compte tenu de la brèche ouverte aux
ressortissants de la communauté européenne à
qui le droit de vote est accordé aux élections locales,
il pourrait être envisageable de se prononcer en faveur de l'octroi
de ce nouveau droit aux étrangers non communautaires, résidant
durablement en France. Cette réforme serait une étape
vers l'établissement de nouvelles conditions d'accès
à la nationalité française pour les étrangers.

|
|
La qualité de la gestion d'une collectivité
dépend de la vitalité de la vie publique locale qui ne peut
se cantonner expressément aux seuls élus. |
2 - Développer et s'appuyer
sur les citoyens
La responsabilité de la gestion d'une collectivité,
telle une commune ou un département, incombe à ceux
que les citoyens ont désignés pour les représenter.
Pour autant, la qualité de cette gestion dépend de la
vitalité de la vie publique locale qui ne peut se cantonner
expressément aux seuls élus. Ceci suppose l'existence
de forces capables de stimuler la réflexion qui permettra au
final de définir le meilleur projet pour la collectivité,
dans l'intérêt général. Cet objectif implique
le rejet de toutes les formes de ghettoïsation et la condamnation
du communautarisme.
Il faudra encourager la participation des jeunes, en
particulier ceux issus des quartiers populaires et de l'immigration
pour qu'ils s'impliquent dans les prochaines élections municipales
et cantonales.

|
|
En créant un véritable statut du bénévolat
et en reconnaissant au milieu associatif son pouvoir de propositions,
ce secteur retrouvera son dynamisme et les bénévoles qui
l'ont délaissé. |
2.1. S'appuyer sur le tissu associatif et syndical
La place des associations et des syndicats dans les
discussions portant sur les politiques locales doit être privilégiée.
Formidable école de la citoyenneté, le monde associatif
a trop longtemps été délaissé dans l'élaboration
des projets. Pourtant, de par le dévouement qu'il rassemble,
il est au plus près des réalités de terrain.
Les pratiques individualistes ont eu tendance ces dernières
années à transformer les associations en simples prestataires
de service. Le politique recouvre une part de responsabilité.
En créant un véritable statut du bénévolat
et en reconnaissant au milieu associatif son pouvoir de propositions,
ce secteur retrouvera son dynamisme et les bénévoles
qui l'ont délaissé.
Cette redynamisation est particulièrement souhaitable
dans le cas des associations de quartier, des amicales de locataires,
des associations de parents d'élèves, de chômeurs
avec les syndicats, et plus généralement de toutes les
associations où peut être débattu de l'intérêt
général. Leur rôle est complémentaire de
celui des conseils de quartier, dans la mesure où ces derniers
ne disposent pas de structures d'action. Nouer ou renouer des contacts
avec les associations peut être bénéfique pour
le dialogue. Des moyens doivent leur être offerts, comme par
exemple la mise en œuvre de maisons de quartier.

|
|
Pour cela, les élus minoritaires doivent pouvoir
avoir accès à l'ensemble des informations concernant les
politiques menées. |
La reconnaissance et la valorisation du rôle du
tissu associatif nous oblige, dans le respect du concept de "
l'exception culturelle " pour résister à la marchandisation,
à récuser la fiscalisation des associations qui sont
agréées par l'Etat et reconnue d'utilité sociale
et d'intérêt général (associations d'éducation
populaire, etc.).
Dans le cadre du centenaire de la loi 1901, un grand
débat doit être ouvert, tant avec les fédérations
d'éducation populaire ou sportives que les fédérations
plus modestes, sur le renouvellement des cadres associatifs et l'accès
des jeunes aux responsabilités associatives, école de
démocratie locale.
2.2. Donner à l'opposition les moyens d'exercer
ses responsabilités
Le rôle de l'opposition est essentiel dans la
qualité du débat démocratique. Pour cela, les
élus minoritaires doivent pouvoir avoir accès à
l'ensemble des informations concernant les politiques menées.
Pour jouer le rôle qui est le leur, ils doivent connaître
les dossiers traités, avoir accès aux délibérations
et posséder des moyens nécessaires pour l'exercice de
leur mandat (assistants, permanences, moyens matériels, etc.).
L'attribution de ces moyens participe au bon fonctionnement de la
démocratie.

|
|
La mauvaise image qu'a l'opinion de la vie politique
écarte les citoyens de la chose publique, déséquilibre
le nécessaire débat et finalement laisse grande ouverte
la porte aux extrémismes antirépublicains. |
3 - Faire vivre l'exigence républicaine
La mauvaise image qu'a l'opinion de la vie politique
répond à un double problème, celui des "
affaires ", même si elles sont peu nombreuses, et celui
de la représentativité des élus. Ce double problème
devient un véritable enjeu pour qui veut donner un contenu
à la démocratie.
Cette mauvaise image est dangereuse pour notre démocratie car
elle tend à effacer un des référents de notre
société : le politique. Elle écarte les citoyens
de la chose publique, déséquilibre le nécessaire
débat et finalement laisse grande ouverte la porte aux extrémismes
antirépublicains.
Des mesures ont déjà été prises pour rendre
plus transparente la vie publique. Ces dispositions reposent sur les
articles 14 et 15 de la Déclaration des droits de l'Homme et
du citoyen qui, en substance, indiquent que la société
a un droit de contrôle de la vie publique. L'état du
patrimoine de l'ensemble des élus exerçant une fonction
exécutive sera publié lors de l'élection, tout
comme sont rendues publiques les indemnités allouées
pour l'exercice des mandats. Les commissions d'appel d'offre pour
l'ensemble des chantiers doivent comporter systématiquement
des élus de l'opposition et les résultats de ces commissions
être rendus publics.
Pour autant il reste dans bien des domaines des possibilités
pour rendre encore plus transparente la vie publique et éviter
toutes les tentations qui iraient à l'encontre de l'application
de nos principes républicains.

|
|
Les collectivités publiques et territoriales
doivent développer les potentialités des nouvelles technologies
de l'information et de la communication pour les orienter vers le service
aux citoyens. |
3.1. Limiter le recours aux associations parapubliques
Pour une meilleure lisibilité de l'action publique,
le recours aux structures paramunicipales ou aux délégations
de service public doit être strictement limité et encadré.
Les modalités du contrôle de la gestion, que ce soit
par les élus de l'opposition ou par les citoyens eux-mêmes,
doivent s'exercer dans les mêmes conditions que dans le cas
d'une gestion directe.
3.2. Mettre les nouvelles techniques de communication
au service de la démocratie
La loi du 22 juillet 1978 sur la liberté d'accès
aux documents administratifs doit être appliquée de façon
très ouverte afin de permettre à tout citoyen de contrôler
l'ensemble de l'action publique et en vérifier les modalités.
Les nouvelles technologies de l'information et de la communication
(NTIC) sont une véritable chance pour la démocratie
d'apporter une transparence d'un autre type, sous réserve d'en
faciliter l'accès à tous. Encore faut-il les mettre
au service d'une citoyenneté active. Or, les manœuvres
des grands groupes privés transnationaux s'accélèrent
pour s'emparer des contenus du réseau informatique mondial,
en contrôler l'accès, et faire de chacun de nous des
cibles commerciales et des consommateurs captifs. Face à cette
offensive commerciale, le défi de la démocratie doit
être relevé. Les collectivités publiques et territoriales
doivent développer les potentialités de ces nouveaux
outils pour les orienter vers le service aux citoyens. Elles doivent
en faire les supports d'une information réciproque plus riche,
plus transparente et mieux actualisée et les mettre au service
d'un dialogue facilité et d'échanges plus interactifs.

|
|
L'effort à entreprendre pour la maîtrise
de ces nouveaux outils est à la mesure de l'enjeu. Il s'agit de
créer les conditions d'une République moderne et d'une citoyenneté
renouvelée. |
L'effort à entreprendre pour la maîtrise
de ces nouveaux outils est à la mesure de l'enjeu. Il s'agit
de créer les conditions d'une République moderne et
d'une citoyenneté renouvelée. Pour les plus petites
de nos communes, le coût peut encore être un frein, mais
celui-ci peut être desserré par le développement
des coopérations intercommunales encouragées par la
loi. Pour les plus grandes d'entre elles ou pour les structures intercommunales
et les départements, ce nouvel outil est une chance d'atteindre
une démocratie moins opaque et davantage réactive dans
le temps. Evidemment la qualité de cette nouvelle forme de
contrôle et de participation démocratique dépend
du niveau de l'engagement des élus aux commandes des collectivités.
Mais les nouvelles techniques de communication créent
aussi de nouvelles inégalités, entre ceux qui savent
s'en servir et ceux qui ne savent pas, et entre ceux qui peuvent s'en
servir et ceux qui ne peuvent pas. Les communes ou les structures
intercommunales ont un rôle à jouer pour lutter contre
l'émergence de ces inégalités en aidant à
la création ou même en créant des structures qui
facilitent l'apprentissage et l'accès à ces nouvelles
techniques de communication.

|
|
Démocratiser les institutions locales passe également
par une remise en cause de la présiden-tialisation excessive des
exécutifs locaux et par la recherche d'un travail en équipe
pour la conduite des projets. |
3.3. Evaluer les politiques publiques
Eviter le dépérissement de la démocratie
c'est aussi se donner les moyens de développer l'observation
et l'évaluation des politiques publiques. Il est frappant de
constater à cet égard l'écart croissant existant
entre les procédures d'études d'impact et d'enquête
publique qui conditionnent les décisions d'investissement et
l'absence totale de procédure d'évaluation de l'intérêt
public de la plupart des dépenses de fonctionnement. Des démarches
d'observation et d'évaluation commencent à se développer
au niveau national. Il appartient à présent de les adapter
au plan local, d'améliorer leur mise en place et de réfléchir
à la possibilité de les ouvrir aux associations et au
public.
3.4. Favoriser le travail en équipe
Démocratiser les institutions locales passe également
par une remise en cause de la présidentialisation excessive
des exécutifs locaux et par la recherche d'un travail en équipe
pour la conduite des projets. Pour y mettre un terme, il faut changer
la logique qui a conduit à une dérive partisane des
assemblées et qui ne laisse aux alliés du parti majoritaire
trop souvent une place plus honorifique que décisive. Ces dérives
sont souvent à l'origine des décisions contestées,
des investissements somptuaires, des dépenses de fonctionnement
inutiles, des opérations imposées par en haut car elles
ne permettent pas au contrôle démocratique de fonctionner
convenablement.

|
|
Les femmes ne sont pas une catégorie sociale,
elles participent de toutes les catégories. |
Nous devons veiller à offrir le meilleur service
au moindre coût, mais pour autant la gestion d'une collectivité
ne peut être celle d'une entreprise. L'élu ne peut donc
se transformer en entrepreneur, car si l'entreprise est stimulée
avant tout par la recherche du profit, la collectivité est
animée par l'esprit du service public et la recherche de l'intérêt
général de ses administrés.
3.5. L'accès des femmes aux fonctions électives
Deux siècles après la Déclaration
des droits de l'Homme et du citoyen, la France doit prendre les moyens
de la mise en œuvre d'une réelle universalité d'accès
aux fonctions et responsabilités politiques par la représentation
équilibrée des deux composantes hommes et femmes du
genre humain.
Les femmes ne sont pas une catégorie sociale, elles participent
de toutes les catégories. En ce sens, la parité dans
les listes aux élections à la proportionnelle comme
la parité dans les cantons et circonscriptions gagnables, plus
encore que les autres, restent un objectif à atteindre.

|
|
La démocratie a besoin de prévoir le renforcement
des droits des élus à exercer leur mandat par l'octroi de
crédits d'heures et d'indemnisations suffisantes au même
titre que ce qui existe pour l'exercice du droit syndical |
3.6. Améliorer la représentativité
des élus
Enfin le fossé entre les élus et les citoyens
sera comblé lorsque ces derniers pourront vérifier que
leurs représentants sont véritablement représentatifs
de l'électorat. Un effort des partis politiques doit être
fait pour une meilleure représentativité des élus
alors qu'à l'Assemblée nationale les ouvriers ne représentent
que 0,5 % des députés, les employés 5,4 % contre
22,4 % pour les enseignants ou encore 18,5 % pour les fonctionnaires
et 17,5 % pour les professions libérales. La démocratie
a besoin de prévoir le renforcement des droits des élus
à exercer leur mandat par l'octroi de crédits d'heures
et d'indemnisations suffisantes au même titre que ce qui existe
pour l'exercice du droit syndical (retour dans l'entreprise, avancement,
retraite, etc.). Il faudrait également créer une mutuelle
paritaire pour, si nécessaire, indemniser les élus en
cas de chômage et favoriser leur réinsertion.
Pour les élections locales, la constitution équilibrée
d'équipes, laissant toute leur place aux femmes et aux jeunes,
aux représentants du milieu associatif et syndical, mais aussi
à toutes les catégories socioprofessionnelles qui font
la richesse de notre pays et de nos cités, empêchera
la confiscation du pouvoir par quelques catégories dominantes
qui malheureusement n'ont pas toujours à l'esprit la recherche
du bien commun. Cela passe évidemment aussi par une limitation
du cumul des mandats.
Enfin, pour assurer une meilleure cohésion politique des conseils
généraux il serait souhaitable d'élire l'ensemble
des conseillers en une seule fois.


|