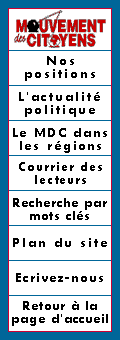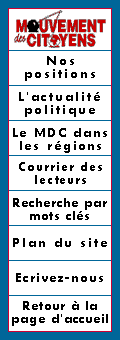|
Nos pères
fondateurs ne sont ni Jean Monnet ni Robert Schumann, ils sont beaucoup
plus anciens et ils s'appellent Sisyphe qui se doit d'être heureux,
malgré son rocher et Prométhée qui est le génie
laïc par excellence. |
Mais,
constatons que l'Allemagne a fait sa réunification et elle
a tourné la page de la CDU dans un grand élan national.
De même, l'Italie a mis un terme à la deuxième
République et elle a porté sur les fonds baptismaux
une formule nouvelle, dans un cadre national. Comme nous l'avons dit
à l'instant en citant Valéry "on ne peut détruire
que ce qu'on remplace". Or il y a un lien évident entre
la nation et la démocratie.
Le
cinquième repère est de donner un horizon aux politiques
publiques et sociales (thème de la table ronde). Comment le
faire dans cet univers de la globalisation sauvage ? Dans les rapports
préparatoires au colloque, nous avons vu qu'elle puise ses
racines dans le triomphe de l'ultralibéralisme au début
des années 80. Bien entendu, aussi dans l'immense bouleversement
du monde de 1989 à 1991, à la veille de la création
du MDC quand nous avons voulu essayer de redonner des repères
dans ce monde très difficile. Nos pères fondateurs ne
sont ni Jean Monnet ni Robert Schumann, ils sont beaucoup plus anciens
et ils s'appellent Sisyphe qui se doit d'être heureux, malgré
son rocher et Prométhée qui est le génie laïc
par excellence.

|
|
L'intervention
de Joschka Fischer était donc intéressante car d'une certaine
manière, il a procédé, en pointant la crise de l'Union
européenne, à un formidable aveu qui jusqu'à présent
n'avait été fait que dans des cénacles très
fermés. |
Avant de pousser plus avant mon intervention, je veux remercier les
organisateurs Gisèle Sebag, Marinette Bache, Isabelle Mazzaschi
et toute l'équipe de la rue du Faubourg Poissonnière.
Remercier aussi pour le rapport introductif Sami Naïr, Jean-Yves
Autexier, Dominique Garabiol, Patrick Rigaudière et bien entendu
les intervenants : Danielle Auroi, Régis Debray, Sylvain Hercberg
et ce matin, Philippe Grasset bien sûr, dont je tiens à
saluer la qualité de la publication de la défense qui
est une chose remarquable (je lisais, déjà, cette revue
quand j'étais Ministre de la Défense qui m'apprenait
beaucoup plus de choses que de nombreux rapports). Jean-François
Kahn, Bernard Cassen, Brigitte Sauzay, Gérard Lafay, Bernard
Moss, et les autres.
Je
souhaite remercier outre les participants, Joschka Fischer qui est,
en quelque sorte, la vedette américaine de notre colloque.
Comme vous le savez, il a pris la précaution avant de prononcer
sa désormais célèbre intervention à l'université
de Humboldt, de préciser qu'il s'exprimait à titre personnel.
L'intervention de Joschka Fischer était donc intéressante
car d'une certaine manière, il a procédé, en
pointant la crise de l'Union européenne, à un formidable
aveu qui jusqu'à présent n'avait été fait
que dans des cénacles très fermés.

|
|
L'Europe
s'est toujours faite à travers des réglementations concernant
les petites choses ; elle s'est rarement définie par un projet
clair sur les grandes. |
Effectivement,
la construction européenne telle qu'elle s'est développée
depuis une cinquantaine d'années c'est-à-dire depuis
la déclaration de Robert Schuman et la CECA est aujourd'hui
derrière nous. Il a ajouté qu'il ne voulait pas que
l'on fasse des titres après son intervention, moi non plus,
pas davantage que les titres faits après la sienne !
Nous sommes
en face de la crise d'un certain type de construction européenne
que l'on pourrait appeler l'Europe qui progresse de biais, qui ne
dit jamais où elle va, qui procède par détours,
qui veut créer des faits accomplis en dehors de tout débat
démocratique de façon à pouvoir contourner la
Démocratie et les Nations, cadres par excellence du débat
démocratique.
Cette
méthode décrite par Joschka Fischer comme la méthode
inductive chère à Jean Monnet : la proposition de la
Commission puis le Conseil qui délibère en secret, tout
cela c'est du passé. Bien évidemment, cette méthode
n'a jamais réussi à définir la "subsidiarité".
La raison en est simple : l'Europe s'est toujours faite à travers
des réglementations concernant les petites choses ; elle s'est
rarement définie par un projet clair sur les grandes.

|
|
Le traité
de Maastricht le dit très clairement : toute politique est désormais
obligée de "se conformer au principe d'une économie
ouverte où la concurrence est libre". |
Les
nations se sont déchargées sur l'Europe de l'accessoire
où elle excelle, et de l'essentiel qu'elle néglige.
C'est d'ailleurs ce que nous lui reprochons. L'intérêt
général européen n'est pas porté par la
Commission ; c'est une frénésie du pouvoir qui développe
des programmes ambitieux dont on ne perçoit pas toujours le
projet qui est derrière. En fait c'est l'idéologie libérale
comme le rappelait si bien Sylvain Hercberg à propos du régime
de l'électricité et du gaz. Il s'agit toujours d'ouvrir
la voie aux grandes sociétés, aux grands intérêts.
L'intérêt général est peu porté
par le Conseil parce que le Conseil est un lieu de compromis, les
débats s'y déroulent à huis clos. En l'absence
de débat démocratique, je ne sais pas si l'on peut définir
un intérêt général. Autrefois,
c'était le privilège des princes : dans la république
de Jean Bodin par exemple. Nous pourrions penser qu'à notre
époque, l'intérêt général ne vaut
rien sans un débat public. Par ailleurs, les institutions de
Bruxelles sont surdéterminées par la philosophie libérale.
Le traité de Maastricht le dit très clairement : toute
politique est désormais obligée de "se conformer
au principe d'une économie ouverte où la concurrence
est libre". Par conséquent, toute politique qui s'inscrirait
dans une autre perspective est rognée.

|
|
La Grande-Bretagne
se conçoit naturellement comme un pont entre l'Europe et le monde
anglo-saxon. |
Enfin,
la plupart des pays européens se trouvent aujourd'hui dans
le sillage des Etats-Unis par une étrange mésestimation
de ce qu'est l'Europe et son histoire et de ce que sont nos capacités.
Pour
des raisons historiques, géopolitiques diverses, c'est le cas
de presque tous les pays européens.
La
Grande-Bretagne se conçoit naturellement comme un pont entre
l'Europe d'une part et le monde anglo-saxon et bien sûr les
Etats-Unis. Elle voit là un dessein national. M. Blair explique
d'ailleurs que Londres est la capitale du monde : il voit Londres
sur ce pont entre l'Europe et les Etats-Unis, le Commonwealth, le
monde anglophone.

|
|
L'Allemagne
a beaucoup de peine à trouver un chemin entre sa conception de
la nation qui était celle du VOLK dont elle ne veut plus parce
qu'elle pressent que c'est là la racine des déraillements
successifs qui l'ont conduit à la prise du pouvoir de Hitler en
1933 et elle fuit dans le post-national où elle retrouve d'ailleurs
sa tradition anté-nationale c'est-à-dire la tradition du
Saint-Empire. |
L'Allemagne
reste marquée par le traumatisme de la période du national-socialisme.
Quoi de plus explicable d'ailleurs ? Psychologiquement, elle sait
gré aux Etats-Unis de l'avoir délivrée du Mal
et de lui avoir rendu sa liberté et son unité. Cela
crée un lien de dépendance évident. Au fond,
l'Allemagne fait commencer son histoire au lendemain de la seconde
guerre mondiale. Ou alors, elle revient avant même la formation
de la nation allemande au stade anté-national, celui du Saint
Empire. L'Allemagne diabolise encore le concept de nation. Elle a
beaucoup de peine à trouver un chemin entre sa conception de
la nation qui était celle du VOLK dont elle ne veut plus parce
qu'elle pressent que c'est là la racine des déraillements
successifs qui l'ont conduit à la prise du pouvoir de Hitler
en 1933 et elle fuit dans le post-national où elle retrouve
d'ailleurs sa tradition anté-nationale c'est-à-dire
la tradition du Saint-Empire. Sa vision n'est pas fixée ; cette
grande nation n'a pas encore pris toute sa mesure de ce qu'a été
son histoire depuis près de deux siècles. On peut considérer
que dans la conception de Fichte, il y avait un certain nombre de
facteurs qui nécessairement n'entraînaient pas du tout
le nazisme mais l'ont favorisé. Puis, il y eut une série
de déraillements successifs à travers l'échec
de la révolution libérale en 1848 et le triomphe de
Bismarck.

|
|
Elle ne conteste
pas le "new world order" (le nouvel ordre du monde) : l'Allemagne
est très contente finalement d'intervenir sous la bannière
de l'OTAN au KOSOVO. |
Tout
cela est très difficile à expliquer mais, nous comprenons
parfaitement que l'Allemagne aujourd'hui inscrive sa politique extérieure
et surtout sa politique d'ouverture à l'Est, dans le sillage
de la politique américaine. Par conséquent, elle ne
conteste pas le "new world order" (le nouvel ordre du monde)
: l'Allemagne est très contente finalement d'intervenir sous
la bannière de l'OTAN au KOSOVO. A ses yeux, c'était
presque une réhabilitation, car c'était la première
fois que l'on voyait des soldats allemands en dehors des frontières
de l'Allemagne, depuis la deuxième guerre mondiale. Et en définitive,
ils ne se posaient guère le problème de savoir si cette
guerre était juste ou non, nécessaire ou non.
Je
pourrais évoquer les pays de l'Europe du sud : l'Espagne, l'Italie
qui sont de grandes nations mais qui pensent toujours pouvoir développer
vis-à-vis des Etats-Unis une stratégie d'influence ;
notamment les Italiens à travers la forte communauté
italienne vivant aux Etats-Unis. L'Espagne, dans la phase historique
actuelle correspondant à sa réintégration au
sein de l'Europe, ne veut pas s'isoler bien qu'elle ait intérêt
à affirmer à l'avenir une ligne européenne indépendante.

|
|
Les pays
de l'Europe du Nord depuis Narvik et depuis l'invasion de la Hollande
et de la Belgique en 1940ont considéré qu'ils ne pouvaient
plus attendre de secours de la France et de la Grande-Bretagne donc, ils
regardent vers les Etats-Unis. |
Je
ne parlerai pas des pays de l'Europe du Nord parce que depuis Narvik
et depuis l'invasion de la Hollande et de la Belgique en 1940 ils
ont considéré, en effet, qu'ils ne pouvaient plus attendre
de secours de la France et de la Grande-Bretagne donc, ils regardent
vers les Etats-Unis.
Nous
pouvons dire la même chose des pays de l'Europe centrale : la
Pologne en particulier, depuis la deuxième guerre mondiale.
Coincés entre la Russie d'un côté et l'Allemagne
de l'autre, ils regardent bien évidemment d'abord vers les
Etats-Unis.
Tous ces éléments rendent la construction d'une Europe
européenne particulièrement difficile. D'autant plus
difficile que l'Europe qui s'est développée est une
Europe libérale qui ne sert pas de contrepoids ou de rempart
par rapport à la globalisation sauvage mettant au premier plan
les marchés financiers. Elle fonctionne beaucoup plus comme
un relais de cette globalisation.

|
|
On s'intéresse
à la communication pour la communication. Ce monde est celui de
la communication vide, l'originalité du message ne se voit pas. |
Du
point de vue de la culture et de la civilisation ; qu'est ce que l'Europe
est aujourd'hui capable de dire qui soit très différent
du discours qui nous vient des Etats-Unis ?
Nous
sommes, me semble t-il, dans la civilisation des tuyaux, civilisation
de l'image, d'Internet, du transport de données. On s'intéresse
à la communication pour la communication. Ce monde est celui
de la communication vide, l'originalité du message ne se voit
pas. Les concepts triomphants en Europe, parfois même plus qu'aux
Etats-Unis, sont les thèmes de la fin de l'histoire, le thème
de la nouvelle économie qui renverrait l'économie traditionnelle
au vestiaire qui déjà nous fait entrer dans une société
duale où il y a d'un côté, les "branchés"
et de l'autre, les "débranchés". Cette Europe
ne s'est pas donné les moyens de gagner la guerre des contenus
parce qu'elle n'a pas de projet, de visée "civilisationnelle"
dans le domaine de la production d'informations, d'images, de biens
culturels. En matière de formation, ce qui vient d'Amérique
a une puissance extraordinaire. Heureusement, l'AFP résiste
encore mais pour combien de temps ? Pour maintenir, le rayonnement
de nos universités et de la science française, il faut
se battre. A cela s'ajoute, le poids du politiquement correct et du
nouveau cléricalisme évoqué par Régis
Debray. Pour nous exprimer, nous devons aller à contre-courant.
Mais ce que nous disons est important parce que cela dérange
et cela crée des repères dans le paysage.

|
|
Il suffirait
d'un dollar faible pour des raisons décidées par le trésor
américain pour que l'euro remonte. Ce n'est pas nous qui décidons,
en dernier ressort, de la force ou de la faiblesse de l'euro. Cette faiblesse
révèle surtout l'inconsistance de l'idée politique
qui sous-tend le projet de l'euro. |
J'évoquais
la crise de la construction européenne, l'absence d'un projet
de civilisation. La faiblesse de l'euro fait couler beaucoup d'encre,
mais le MDC l'ayant souhaitée ne la déplore pas. Nous
l'avions posé comme une des conditions de possibilité
de l'euro, avec l'inclusion des pays d'Europe du Sud. Un euro large
devait immanquablement contribuer à ce qu'il fût faible.
Mais, comme l'a relevé Gerhard Schröder, ce n'est pas
une catastrophe, il n'y avait pas lieu de monter sur les barricades
parce que l'euro est trop faible. En effet, le taux de chômage
dans l'Union Européenne reste en moyenne à 10%, beaucoup
plus qu'aux Etats-Unis et au Japon. L'euro faible n'est pas une mauvaise
chose car il dope les exportations et la croissance (c'est le cas
en Allemagne et en France). Après les années de pénitence
que nous avons connues après la conclusion du traité
de Maastricht et même avant avec le franc fort (l'alignement
du franc sur le mark) nous apprécions un peu de répit.
Evidemment, le risque est le relèvement des taux d'intérêt
par la Banque centrale européenne qui est une banque indépendante,
en l'absence de tout contrôle politique et de tout gouvernement
économique. Depuis deux ans, ce qui se passe montre clairement
que la faiblesse de l'Euro n'est que l'envers de la force du dollar.
En effet, il suffirait d'un dollar faible pour des raisons décidées
par le trésor américain (ce fut le cas au début
de la décennie 90) pour que l'euro remonte. Ce n'est pas nous
qui décidons, en dernier ressort, de la force ou de la faiblesse
de l'euro. Cette faiblesse révèle surtout l'inconsistance
de l'idée politique qui sous-tend le projet de l'euro. Nous
avons voulu créer la première monnaie sans Etat, avant
d'avoir façonné une identité politique européenne
autour d'un projet politique.

|
|
Toujours
au titre de la crise des institutions européennes, le blocage actuel
résulte du choix de l'élargissement fait au lendemain même
de la conclusion du traité de Maastricht sous l'impulsion du chancelier
Kohl. |
Toujours
au titre de la crise des institutions européennes, le blocage
actuel résulte du choix de l'élargissement fait au lendemain
même de la conclusion du traité de Maastricht sous l'impulsion
du chancelier Kohl au sommet de Copenhague, l'ouverture aux pays d'Europe
centrale et orientale. A 15, le fonctionnement des institutions est
déjà bloqué. Nous le voyons au niveau de la Commission
avec notamment l'épisode Santer et Romano Prodi qui, il y a
un an, apparaissait comme un sauveur ne l'est plus tout à fait
aujourd'hui. Le parlement européen qui était conçu
pour aider la Commission à s'affirmer vis-à-vis du Conseil
se met à la contester !
Dans
le Conseil, c'est absolument sidérant : nous assistons à
15 monologues et plus encore lors des Conseils JAI (Justice Affaires
Intérieures) où deux ministres sont présents
(30 au total). Tandis que les malheureux derniers Présidents
finlandais ou portugais doivent faire la synthèse. Je renvoie
à Danielle Auroi et à Sami Naïr le soin de vous
décrire les débats du Parlement Européen. Cela
ressemble à une grande volière. En approfondissant un
peu, nous pourrions y trouver du bon. J'ai toujours dit que le Parlement
européen pouvait être un forum utile. Définir
un intérêt général commun est de plus en
plus difficile lorsque le nombre des participants s'accroît.

|
|
La première
tentation est celle de l'Europe contentieuse qui va avec l'Europe libérale.
Lorsque
la jurisprudence européenne se sera établie à travers
des décisions qui s'imposeront au législateur français,
petit à petit les parlements seront dessaisis de leur droit de
légiférer.
|
Ce
blocage évident doit nous amener à trouver une solution.
Amsterdam a déjà échoué. La CIG (conférence
inter-gouvernementale) devait, au terme du Traité de Maastricht,
faire un bilan en 1996 et redresser ce qui ne marchait pas. Mais,
nous n'avons pas réussi à redimensionner ces institutions
alors que nous n'étions que 15. Alors, le traité d'Amsterdam
a, faute de mieux, communautarisé les problèmes d'asile
et d'immigration.
Pour sortir de cette crise, deux tentations se font jour : elles ne
sont pas forcément alternatives ou contradictoires.
La première tentation est celle de l'Europe contentieuse qui
va avec l'Europe libérale. Ce projet de charte des droits fondamentaux
devrait être élaboré pour le sommet de Nice. Cela
ne me semble pas tout à fait innocent car nous avons déjà
au niveau européen, la convention de sauvegarde des droits
de l'homme qui induit une jurisprudence qui a amené la loi
française à évoluer. Par exemple, dans le domaine
du regroupement familial, nous avons repris l'article 8 de la convention
européenne des droits de l'homme : celle-ci est déjà
une convention au niveau du Conseil de l'Europe. Y ajouter une charte
des droits fondamentaux entraînera inévitablement un
conflit. Plus grave encore, nous subvertissons toute la hiérarchie
des normes juridiques en France. Lorsque la jurisprudence européenne
se sera établie à travers des décisions qui s'imposeront
au législateur français, petit à petit les parlements
seront dessaisis de leur droit de légiférer.

|
|
Tout l'édifice
du "bloc de constitutionnalité" forgé par le Conseil
Constitutionnel, depuis le début des années 60, se trouvera
remis en cause. |
Tout
l'édifice du "bloc de constitutionnalité"
forgé par le Conseil Constitutionnel, depuis le début
des années 60, se trouvera remis en cause. Le Conseil Constitutionnel
a défini ce bloc de constitutionnalité à partir
du préambule de la Constitution de 1946 et de 1958, de la Déclaration
des Droits de l'Homme et du Citoyen et même des droits fondamentaux.
A partir du moment où la Charte des droits fondamentaux aurait
une vertu contraignante, si elle était incluse dans un traité
européen, tout cet édifice serait détruit au
profit du pouvoir des juges européens. Donc, la tentation est
grande de s'engouffrer dans cette brèche. Et parce que c'est
très démagogique, on nous fera valoir que ce seraient
des droits sociaux. Un certain nombre de pays et pas seulement la
Grande Bretagne s'y opposeront puis, l'inégalité est
telle entre le Portugal et l'Allemagne que nous n'irons que jusqu'à
un degré très général dans cette direction.
Mais on y ajoutera les droits civils et politiques et pourquoi pas
le droit à l'éducation bien que ce dernier échappe,
en principe, à la compétence de la Commission européenne
et de l'Union européenne. Déjà, j'ai pu voir
dans des moutures de textes issus des travaux de la Convention pour
la charte fondamentale présidée par Roman Herzog, ancien
président de RFA, que le principe de laïcité n'existe
plus ; on pose simplement le principe de la gratuité de l'enseignement
dès lors que l'éducation serait obligatoire.

|
|
Ce projet
de charte des droits fondamentaux va très bien avec l'idée
d'une Europe qui ne serait plus qu'une grande zone de libre échange,
régulée par la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés
européennes. |
Ceci
est très insuffisant ; ce projet de charte des droits fondamentaux
va très bien avec l'idée d'une Europe qui ne serait
plus qu'une grande zone de libre échange, régulée
par la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés
européennes. Je crains que le Conseil européen soit
mis devant le fait accompli, dans quelques semaines, au Portugal et
plus encore, au sommet de Nice. Lorsque cette charte sera avalisée,
nous nous trouverons encore plus devant le diktat du "politiquement
correct". Comment combattre une charte des droits fondamentaux
sans passer pour un hérétique, quelqu'un ne voulant
pas reconnaître des droits ! En Europe, non seulement en France,
l'action des gouvernements doit de plus en plus se conformer à
la grande maxime : "On ne peut pas ne pas". "On ne
peut pas ne pas bombarder Belgrade" parce que nous avons dit
que nous le ferions. "On ne peut pas ne pas envoyer des policiers
au Kosovo" parce qu'un certain nombre de personnes s'étripent,
même si ce problème dépasse bien évidemment
la compétence des policiers qui ne parlent pas la langue du
pays, n'en connaissent pas le droit, et qui agiraient en dehors du
contrôle de juges qui n'existent pas.

|
|
Cette démocratie
appelée contentieuse est très loin de la Démocratie
parce qu'elle n'est accessible qu'à ceux qui peuvent se payer des
avocats. |
Tout
simplement on ne veut pas peser le problème politique du statut
du Kosovo. Le poids du politiquement correct est terrible. Le Conseil
Européen de Nice ne pourra donc pas ne pas donner son satisfecit
et plus que cela, son accord à un projet mitonné dans
le plus grand secret. "On ne peut pas ne pas" est le vrai
ressort de la plupart de nos politiques. Nous ne faisons plus ce qu'il
est juste et bon de faire, du point de vue de l'intérêt
général. Nous donnons notre accord à telle politique
parce que nous ne pouvons pas décemment la refuser. Ceci procède
de cette "emprise" que décrivait Régis Debray
qui, politiquement, se traduit par "on ne peut pas ne pas".
Le grand risque comme l'a pointé le rapport introductif, c'est
le règne du marché plus le règne des "lawyers".
Cette démocratie appelée contentieuse est très
loin de la Démocratie parce qu'elle n'est accessible qu'à
ceux qui peuvent se payer des avocats.

|
|
Une autre
tentation, pas forcément contradictoire et davantage inscrite dans
l'actualité, est le projet de Joschka Fischer d'une Europe fédérale. |
Une
autre tentation, pas forcément contradictoire et davantage
inscrite dans l'actualité, est le projet de Joschka Fischer
d'une Europe fédérale. Tout d'abord, je voudrais pointer
une certaine continuité avec l'idée que l'on trouvait
dans le rapport "Schaüble-Lamers", de 1994, ces leaders
de la CDU, réclamant en 1994 un noyau dur européen autour
de quatre ou cinq pays. Joschka Fischer envisage de pouvoir être
à onze dans le cadre de l'euro et ajoute que cela pourrait
s'agrandir. Nous voyons bien comment l'Allemagne, tout naturellement,
est amenée à plaquer son modèle fédéral
sur l'idée qu'elle se fait de l'Europe future et de son fonctionnement.
La
proposition de Joschka Fischer vaut d'abord comme aveu d'une crise
irréversible de la méthode Monnet et du modèle
d'institutions européennes qui s'est développé
depuis une quarantaine d'années. Nous voyons aussi que l'idée
de définir des domaines de souveraineté distincts, à
un niveau pour la fédération, à un autre laissé
aux Etats, est en contradiction complète avec l'Europe telle
qu'elle existe où ce qui figure, au niveau des acquis communautaires
est surtout : la réglementation de la chasse, la fixation de
normes pour les véhicules, les fromages, etc. Tout cela n'a
absolument rien à voir avec l'idée de s'occuper au niveau
européen de diplomatie, de défense, de monnaie, etc.
Tandis que tout ce qui est subsidiaire serait laissé aux nations.

|
|
Joschka Fischer
raisonne en termes de compétences alors qu'il faudrait mettre en
avant un projet de civilisation qui soit aussi un projet géopolitique. |
Alors
comment passe-t-on d'un système à l'autre ? J'aimerais
que Joschka Fischer nous explique cette transition qui selon lui serait
une transition à long terme. Le reproche que l'on pourrait
faire à la proposition de Joschka Fischer, c'est d'être
avant tout une solution technique, procédurale apportée
au problème de la crise de la construction européenne.
Ce n'est pas une réponse politique, car il ne définit
pas un projet politique pour l'Europe du XXIème siècle.
Joschka Fischer définit une répartition assez mystérieuse
des compétences entre deux niveaux : il raisonne en termes
de compétences alors qu'il faudrait mettre en avant un projet
de civilisation qui soit aussi un projet géopolitique. Sa conception
enfin est dépassée : on ne peut pas, sans aller au rebours
de l'histoire, substituer à ce que l'on appelait "le mur
de la honte", un mur de l'argent fut-il celui de l'Euro 11. Cette
idée d'un noyau dur fédéral, à l'intérieur
de l'Europe de l'après-communisme, est un contresens historique.
Il manifeste simplement la fuite dans le postnational qu'est aussi
la résurgence du rêve nostalgique du Saint Empire romain
germanique qui ferait remonter tout le cours de l'histoire européenne
sur un millénaire. Ce rêve traduit la difficulté
de l'Allemagne à s'affranchir de son ancienne conception du
Volk pour inventer un concept de nation citoyenne, à la mesure
d'une histoire tellement riche qu'elle n'arrive pas encore à
la dominer.

|
|
Dans le post-national,
elle renoue inconsciemment avec sa tradition anté-nationale parce
qu'après ce déraillement catastrophique qu'a été,
dans son histoire, l'épisode nazi elle continue à diaboliser
le concept de nation. |
Il
est absurde de ne pas pouvoir se référer innocemment
aux Romantiques allemands parce qu'on nous expliquera que c'est dans
ce romantisme allemand que l'histoire ultérieure de l'Allemagne
plonge ses racines. Cela n'est pas sérieux, on doit pouvoir
aimer les romantiques allemands sans être pour autant suspect
d'une quelconque inclination pour ce qui a suivi. En réalité,
l'Allemagne fait dans le post-national. Vous connaissez les théories
de Jürgen Habermas sur ce sujet : une espèce de conception
de la nation purement civique, totalement déconnectée
de l'histoire réelle. Dans le post-national, elle renoue inconsciemment
avec sa tradition anté-nationale parce qu'après ce déraillement
catastrophique qu'a été, dans son histoire, l'épisode
nazi elle continue à diaboliser le concept de nation.
Nous
devons donc privilégier le dialogue de fond avec l'Allemagne
parce que de toute évidence, l'Europe est ainsi faite : il
y a les peuples du Nord et les peuples du Sud, les peuples germaniques
et les peuples latins.

|
|
La réforme
du code de la nationalité en Allemagne a été un moment
extrêmement important car en changeant la définition de l'étranger,
on change forcément aussi la définition de l'Allemand. |
La France et l'Allemagne sont les deux pays les plus étroitement
connectés l'un à l'autre, par lesquels tout passe. Sans
cette critique de la conception du Volk et l'affirmation d'une conception
de la nation citoyenne allemande, nous ne pourrons pas fonder une
relation saine avec elle. Plus simplement, je dirais qu'entre les
thèses "völkisch" de Jörg Haider et le
concept postnational de Jürgen Habermas, il y a place pour une
conception citoyenne de la nation allemande capable de mettre ce grand
peuple en mesure de relever les défis du XXIème siècle
dans une relation fraternelle avec la France. Il est évident
que ce discours n'est pas aujourd'hui le discours dominant, pourtant
si l'on veut bien réfléchir au problème de l'identité
en Europe , c'est bien là que se situe le blocage, entre l'identité
républicaine articulée à l'universel et des conceptions
dépassées de la nation souche. Même si l'Allemagne
a beaucoup bougé grâce notamment à la victoire
du chancelier Gerhard Schröder et au gouvernement SPD Vert :
ainsi la réforme du code de la nationalité en Allemagne
a été un moment extrêmement important car en changeant
la définition de l'étranger, on change forcément
aussi la définition de l'Allemand. Mais, c'est un effort de
longue haleine.

|
|
Aucune Europe
ne vaut qui ne repose d'abord sur un dessein politique : l'Europe sera
un projet ou ne sera pas. |
Quelle
Europe voulons-nous construire ? Aucune Europe ne vaut qui ne repose
d'abord sur un dessein politique : l'Europe sera un projet ou ne sera
pas.
Un
projet de civilisation, j'ai évoqué la révolution
des contenus. Un autre rapport au temps et sans doute aussi aux médias.
A ce propos, la réflexion de Régis Debray sur la médiologie
nous intéresse au plus haut point.
Un
projet géopolitique aussi, parce qu'il n'y a pas d'Europe européenne,
il n'y a pas d'Europe indépendante dans le monde tel qu'il
est, s'il ne s'établit pas un axe Paris-Berlin-Moscou, qui
est l'axe de l'indépendance européenne. Bien entendu,
beaucoup de problèmes se posent. Si nous voulons faire l'économie
d'une réflexion stratégique à long terme dans
nos rapports avec la Russie, nous ne ferons jamais autre chose qu'une
succursale américaine. Il nous faut donc savoir si nous sommes
inféodés définitivement à l'Amérique
ou si nous voulons bâtir un monde multipolaire, choix qui conditionne
tout le reste. Et puis, l'Europe ne peut pas ignorer la Méditerranée,
le Maghreb, la Turquie, la nécessaire solution des problèmes
qui se posent au Proche-Orient et d'abord la construction d'un Etat
palestinien qui soit aussi une garantie de sécurité
pour Israël.

|
|
Puis en dernier
ressort, ce qui est en cause, c'est bien le rapport de l'Europe aux Etats-Unis. |
Puis
en dernier ressort, ce qui est en cause, c'est bien le rapport de
l'Europe aux Etats-Unis. Serons-nous une banlieue, même riche,
de l'Empire américain, une sorte de Ligue Hanséatique
du troisième millénaire ? Basculerons-nous vers une
espèce de grande Suisse ? Nous sommes-nous résignés
à ne plus compter dans l'avenir du monde sauf sous l'angle
des expéditions humanitaires et des ONG que nous pouvons effectivement
envoyer ici et là ? ou entendons-nous redevenir le grand carrefour
du monde que l'Europe a été et qu'elle peut être
à nouveau, pesant de son poids qui est grand pour orienter
la puissance américaine, pas toujours si sûre d'elle-même
? Naturellement, pour cela, nous devons compter avec la Russie, la
Chine, le Japon, l'Inde et d'autres encore. Ce projet d'indépendance
européenne ne peut naître que d'un dialogue entre les
nations, lieu privilégié de la démocratie. Je
ne dis pas que les débats se déroulant au Parlement
européen ne peuvent pas y contribuer. Le Parlement européen
a voté une résolution sur l'Irak demandant la levée
de l'embargo, il a eu un écho peut-être trop modeste
à nos yeux. Enfin, je ne néglige pas ce qui peut être
fait. Mais nous ne pouvons pas faire l'impasse sur les nations parce
que cela signifierait faire l'impasse sur la démocratie.

|
|
L'idée
est naturellement d'aller vers le sentiment d'un destin de plus en plus
partagé, il faut renforcer le dialogue entre les peuples européens,
leur donner le sentiment de ce qu'ils ont à faire ensemble. |
Et
l'Europe doit être une union de nations comme l'avait dit d'ailleurs
Lionel Jospin à la réunion de Milan, l'Europe se fera
dans le prolongement des Nations, non pas contre elles. Le discours
de Joschka Fischer par rapport au projet Shaüble-Lamers marque
tout de même une certaine avancée dans cette direction.
Ce dialogue de fond est particulièrement important pour la
France et l'Allemagne pour les raisons évoquées tout
à l'heure. Dans l'état actuel des choses, je préconiserais
avant même les coopérations renforcées qui sont
un peu "la tarte à la crème", un nouveau traité
de l'Elysée entre la France et l'Allemagne précédé
d'un travail sérieux, approfondi, franc sur un certain nombre
de domaines clés.
L'Europe
elle-même ne pourra être d'abord qu'une confédération
souple d'Etats qui peut être structurée par des coopérations
renforcées par domaine comme l'a évoqué Gérard
Lafay ce matin. Dans des domaines aussi décisifs que la défense,
la diplomatie, la monnaie, l'agriculture, la libre circulation des
personnes. Cela existe déjà, il suffit donc de perfectionner
ce qui existe. Mais, nous ne voyons pas comment les institutions traditionnelles
de l'Union européenne ne perdraient pas un peu de leur substance
si l'on privilégie ces coopérations renforcées.
L'idée est naturellement d'aller vers le sentiment d'un destin
de plus en plus partagé, il faut renforcer le dialogue entre
les peuples européens, leur donner le sentiment de ce qu'ils
ont à faire ensemble.

|
|
Les statuts
de la Banque Européenne n'ont pas été modifiés.
La question du gouvernement économique reste toujours posée
et puis, l'avenir de la Grande-Bretagne et celui de la livre britannique
est évidemment une question essentielle. Ne faudrait-il pas se
donner le temps de voir venir ? |
S'agissant
de l'euro, aujourd'hui monnaie commune, je m'interroge sur le fait
de savoir s'il ne serait pas raisonnable d'y regarder à deux
fois avant de plonger, le 1er janvier 2002, dans la monnaie unique.
Je m'interroge pour deux raisons : il me semble en effet qu'il y a
deux préalables à lever. Tout d'abord, la réforme
du statut de la Banque Centrale Européenne inscrite dans notre
programme commun, MDC-PS pour les élections européennes.
Les statuts de la Banque Européenne n'ont pas été
modifiés. La question du gouvernement économique reste
toujours posée et puis, l'avenir de la Grande-Bretagne et celui
de la livre britannique est évidemment une question essentielle.
Ne faudrait-il pas se donner le temps de voir venir ? Au total, l'Europe
est un processus qui ne peut progresser que si la France reste capable
de faire entendre sa voix ; il y a une cure de désintoxication
"européiste" à mener, il faut sortir de la
téléologie et j'ajoute aussi de la théologie.
Mais enfin, il n'y a pas de téléologie sans théologie
: de ce règne des fins qui sanctifient les moyens. Au nom de
l'Europe, on peut faire n'importe quoi et que chaque fois que quelque
chose ne va pas, comme le rappelait Georges Sarre tout à l'heure,
c'est "faute d'Europe". Il faut réapprendre à
raisonner à partir du monde tel qu'il est, faire entendre la
voix de la France. La faire entendre d'abord au sein de la gauche
plurielle.

|
|
On ne raisonne
pas en effet, dans la perspective des municipales ou des présidentielles.
Nous devons voir plus loin, une France fidèle à l'idée
républicaine qui la porte et qu'elle porte depuis deux siècles. |
C'est en tout cas
la vocation que s'est donnée le Mouvement des Citoyens en choisissant
comme slogan "relever la France avec la Gauche" car la France
est une articulation particulière avec l'universel que l'Europe
ne fournit pas aujourd'hui. Le reste du monde attend encore que la France
joue ce rôle. Le Mouvement des Citoyens a refusé au sein
de la majorité plurielle la voix des surenchères en privilégiant
la cohérence de la majorité gouvernementale. Nous avons
voulu donner au gouvernement de la gauche toutes ses chances et d'une
certaine manière, nous avons pris sur nos épaules un certain
nombre de problèmes qui n'étaient pas parmi les plus faciles.
La pertinence de ce choix se manifestera à la lumière
des résultats de la conférence inter-gouvernementale qui
va s'ouvrir. Quoi qu'il arrive, nous ferons entendre la voix de la France
dans la durée. On ne raisonne pas en effet, dans la perspective
des municipales ou des présidentielles. Nous devons voir plus
loin, une France fidèle à l'idée républicaine
qui la porte et qu'elle porte depuis deux siècles. Mais cette
idée sera la seule qui pourra porter le projet d'une Europe européenne
indépendante, citoyenne. Donc le choix du MDC est de peser autant
que possible et de témoigner autant que nécessaire.
Merci.
|