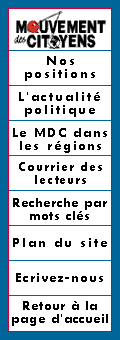|
|
Depuis la chute de la Commune en 1871, une lutte sourde a toujours opposé le pouvoir central à Paris. Car Paris, où sont nées les valeurs de la République, qui fut la matrice des révolutions de 1789, de 1830 et 1848, a longtemps fait peur aux conservateurs, aux nostalgiques qui voyaient dans notre ville, et singulièrement dans ses faubourgs ouvriers de l'est, les ferments de la révolution cherchant à entraîner une province restée fidèle aux valeurs d'ordre de l'ancienne France. Lorsque tombe la Commune de Paris, les tenants de l'ordre bourgeois font tout pour effacer les traces du soulèvement populaire : les insurgés étaient laïques, on bâtit le Sacré-Cœur en expiation, et les élus de la capitale vont, en délégation, au pèlerinage de Paray le Monial. Les insurgés étaient démocrates : on donna à Paris un statut exorbitant du droit communal, qui mit Paris sous la coupe directe de l'Etat. Cette méfiance immémoriale du pouvoir central envers Paris a duré longtemps puisque, jusqu'en 1977, notre ville eut un statut particulier. Deux Préfets, le préfet de Police et le Préfet de la Seine, concentraient entre leurs mains tous les pouvoirs. Le Conseil municipal, bien qu'élu, n'avait qu'un rôle mineur et son président, élu chaque année par le conseil, n'était pas un maire. |
|||
|
|
Cette
situation dura jusqu'à ce que Valéry Giscard d'Estaing
fasse voter, le 31 décembre 1975, une loi réintroduisant
Paris dans le droit commun et permettant, pour la première fois
en 1977, l'élection du Maire de Paris. Avancée notable,
cette loi a été renforcée par la loi dite PML de
1982, votée par le gouvernement de la gauche pour rapprocher
le plus possible le pouvoir du citoyen, dans l'esprit de la décentralisation,
qui consiste à mettre en place des niveaux de responsabilité
permettant de décider au mieux de la vie quotidienne des citadins
dans le respect du citoyen et de ses aspirations, de ses attentes.
Cette loi de 1982, que change-t-elle de fondamental ? Les maires et les conseils d'arrondissement sont désormais élus au suffrage universel alors qu'à partir de 1977, il n'existait que des commissions d'arrondissement composées de trois collèges, l'un d'élus, le second de responsables associatifs, le troisième de personnalités qualifiées. Comme on s'en doute, ces deux derniers collèges, nommés par le maire, ne l'étaient que sur le seul critère de la bien-pensance. |
|||
|
|
Cette
loi PML, la majorité de droite qui gère sans interruption
la ville depuis 1870, l'a délibérément ignorée
car elle considérait qu'elle dérangeait la manière
égoïste et particulière dont elle menait les affaires
de Paris, ville qu'elle gardait repliée à l'abri du périphérique,
sans aucune consultation, concertation ou solidarité avec les
communes voisines.
La droite parisienne avec Jacques Chirac fît un choix politique: faire de Paris un bastion à partir duquel elle allait partir à l'assaut du pouvoir d'Etat. C'est dans cette optique qu'a été mis en place le " système Chirac " qui, s'il a connu une inflexion après 1995, perdure encore. Ce système peut se caractériser ainsi : prise en main totale de l'administration ; clientélisme ; électoralisme, tout geste fait par la municipalité devant se convertir en voix. C'était le règne de l'emprise d'un clan, ou " main basse sur la ville ". Et c'est tout cela qu'il faut désormais changer. Mais attention ! Cette alternance que nous voulons, doit être une vraie alternative, de style et de fond, ce qui passe par un renouvellement massif du personnel politique . Il ne suffit pas de changer les têtes, ou de remplacer un clan par un autre. Non, il faut avoir un programme clair et complet, préciser quels moyens l'on se donne pour l'appliquer, être à l'écoute, non pas des modes, mais des changements de fond qui affectent une population parisienne en pleine mutation sociologique. En un mot : il faut porter un projet global. |
|||
|
|
Déjà en 1995, le résultat des municipales a démontré qu'il existait une attente. Six maires d'arrondissement de gauche ont été élus, résolus à mettre en œuvre une véritable politique de proximité fondée sur la démocratie locale. Les parisiens ne peuvent toutefois encore qu'entrevoir véritablement ce que devrait être la participation locale. En effet, si les mairies de gauche ont contribué à faire évoluer le rapport de forces entre la mairie centrale et les mairies d'arrondissement, l'attitude de la Ville dans l'application de la loi PML crée des frustrations parmi les élus, de l'incompréhension parmi les administrés, et la citoyenneté en souffre, car les parisiens ont l'impression constante que les mairies d'arrondissement et la Ville traitent les problèmes en se renvoyant la balle comme dans une partie de ping-pong. Néanmoins, c'est l'apprentissage de la démocratie qui a commencé et, malgré le poids des habitudes, les pesanteurs du système, quelque chose bouge à Paris. Le premier grand chantier de la gauche républicaine, à Paris, devra donc être d'appliquer la loi PML, d'en mettre en œuvre une lecture positive et dynamique, puis de proposer sa révision, selon les termes de la proposition de loi que j'ai déposée en 1998. Il faut que les choses soient claires : ceux qui voteront pour nous en 2001 se prononceront ipso facto pour transférer aux arrondissements la gestion de tous les équipements de quartier ainsi que des services de la propreté et de l'environnement, avec les effectifs et les moyens matériels et budgétaires y afférant. |
|||
|
|
Plus largement, que voulons-nous pour Paris ? Un statut qui doit permettre une dévolution de pouvoirs aux mairies d'arrondissement, dans tous les domaines que l'intérêt du service public et des citoyens commande de faire gérer au plus près des réalités du terrain. Ce transfert doit être réalisé en sauvegardant l'unité de la capitale. Nous ne sommes pas favorables à ce que les mairies d'arrondissement soient de plein exercice, car il existe une histoire commune aux 20 arrondissements, une identité forte et un sentiment d'appartenance à Paris tout autant qu'à un arrondissement. De surcroît nombre de questions ne peuvent être résolues au niveau de l'arrondissement, l'interdépendance entre ceux-ci étant une réalité incontournable, par exemple pour le règlement de questions comme les transports, la lutte contre la pollution, le développement économique. Il faut donc le dire clairement : Paris sera une commune à part entière, les mairies d'arrondissement ne prélèveront pas l'impôt, le statut du personnel de la Ville sera maintenu. |
|||
|
|
Maintenir
l'unité de la capitale permettra aussi de lui donner les moyens,
qui actuellement manquent, pour que Paris, qui jouit d'un prestige unique
à l'étranger, joue le rôle moteur de force de proposition
et d'innovation qui devrait être le sien parmi les mégalopoles
du monde : développer à tous les niveaux les échanges
avec les villes francophones, attirer les entreprises à haute
valeur ajoutée, tirer parti du fantastique potentiel universitaire
et de recherche qui existe à Paris, tout cela devra être
une priorité .
Les mairies d'arrondissement, elles, ont une vocation de proximité. C'est pourquoi il faudra qu'elles gèrent tous les équipements locaux et disposent de moyens financiers et humains adéquats. Elles devront également gérer les services qui ont une incidence directe et quotidienne sur la vie de chacun : la propreté, des espaces verts, la fonction d'animation et d'information de proximité, les services destinés à la jeunesse, les services culturels de proximité, l'entretien courant et les petites réparations des équipements scolaires. Comment expliquer aux citoyens, par exemple, que les services de propreté, que la Ville a d'ailleurs partiellement privatisés, ne soient pas pilotés par les mairies d'arrondissement, alors qu'ils ont en charge une préoccupation majeure, tangible et immédiate de tous les citoyens ? |
|||
|
|
Tout
cela ne peut être réalisé que par une réforme
de la loi PML. Mais suffit-elle ? Certainement pas. C'est tout le fonctionnement
des institutions parisiennes qui doit être modifié afin
que la Ville soit gérée de manière transparente.
Il faut que les élus décident des choix politiques. Qu'ils
consultent ensuite la population. Qu'enfin l'administration parisienne,
compétente et étendue, élabore des propositions
qu'elle soumet aux élus.
Pour que ceux-ci accomplissent leur travail au mieux, existe une première nécessité : il faut donner au Conseil de Paris, qui est à la fois conseil municipal et conseil général, puisque Paris est à la fois ville et département, des moyens appropriés à la gestion d'une capitale de 2,135 millions d'habitants. Notre assemblée examine actuellement entre 300 et 500 délibérations ou pétitions en une séance d'une journée, exceptionnellement deux, par mois. Cela ne permet que de survoler les enjeux. Il faut donc organiser ces débats sur trois jours au minimum. Pour permettre un travail préparatoire de qualité, les 7 commissions du Conseil doivent, comme cela se pratiquait avant le changement de statut, obligatoirement se réunir autant que de besoin et auditionner des personnalités compétentes extérieures au personnel de la Ville, ou se rendre en mission en province, à l'étranger, pour tirer le meilleur parti des expériences d'autres grandes villes. Ces commissions doivent redevenir des organismes vivants, entreprenants, des lieux de concertation et de conception. |
|||
|
|
Enfin, comme cela se pratique par exemple à Barcelone notamment, les élus, chaque année, se réuniraient en forum avec les institutionnels et ensuite les représentants du monde associatif pour entamer un travail de prospective sur l'avenir de notre ville. Favoriser l'essor de la démocratie locale à Paris, c'est aussi bien sûr impliquer davantage les citoyens et les associations dans la vie des quartiers, de l'arrondissement et de la commune. A cet effet, il faut, comme nous l'avions proposé en novembre 1996 pour ce qui concernait le stationnement, activer le référendum d'initiative locale, équivalent des " votations " suisses, seul moyen de faire trancher la souveraineté populaire sur des questions d'intérêt communal, comme la place de l'automobile dans la ville, sujet de préoccupation majeure des parisiens auquel l'actuelle municipalité n'a répondu que par des effets d'annonce du type " journée sans voitures ". Des questions comme la circulation alternée ou la restriction spectaculaire de la circulation ne peuvent être tranchées que par les parisiens, après un débat démocratique, lors duquel chaque formation politique et association pourra s'exprimer, et qui débouchera sur un vote sur une question simple. |
|||
|
|
Il
importe également de déverrouiller les commissions extra-municipales,
qui sont actuellement de simples chambres d'enregistrement de la majorité
municipale, pour en faire des espaces constructifs d'expression du tissu
associatif. La presse municipale doit s'ouvrir véritablement
au pluralisme, elle qui pour l'instant ne donne à l'opposition
qu'une maigre tribune. Cela implique un changement de contenu du journal
de la Ville, ainsi que la possibilité pour les mairies d'arrondissement
de réaliser dans de bonnes conditions une information complète
des habitants, par un journal notamment. Les parisiens doivent en outre
pouvoir suivre les débats du Conseil de Paris, ce qui implique
d'ouvrir la salle des séances aux caméras de télévision,
comme c'est le cas dans les Assemblées.
Je souhaite également que la gauche, si elle gagne Paris, instaure partout des Comités de Quartiers dotés de véritables pouvoirs d'initiative et qu'elle supprime les CICA, transformés en Forum des Associations. Il existe un très riche tissu associatif parisien : il faut lui permettre de se renforcer, d'abord en créant une Maison des Associations par arrondissement ou groupe d'arrondissements, laquelle offrira des services matériels communs et où les citoyens pourront venir découvrir l'association qui correspond à leur besoin d'engagement. Ensuite, il faut rationaliser et clarifier l'octroi des subventions, suivant le principe de la transparence. Je souhaite donc que les associations aidées puissent rendre compte à la Commission des Finances du Conseil de Paris, donc aux élus, de leurs activités. Toutefois le rapport entre la Ville et les associations doit dépasser le cadre strictement financier : terreau de la démocratie locale, lieu de l'engagement citoyen, les associations doivent faire profiter la Ville de leur expérience. C'est pourquoi nous nous engageons à créer un comité consultatif qui les regroupera, par branche d'activité, et qui sera une force de proposition ainsi qu'un lieu de débats. |
|||
|
|
Une fois déconcentrée au niveau des arrondissements et renforcée par un meilleur fonctionnement de l'assemblée communale, la démocratie locale dans la capitale doit se manifester dans l'ouverture sur la banlieue. Tel est le sens de la proposition de loi que j'ai déposée en janvier 1999 afin de créer un Haut- Conseil de l'agglomération parisienne. Quel est l'objectif de cette institution inter-communale ? Partons d'un constat : Paris et sa banlieue constituent une mégapole de 10 millions d'habitants au sein de laquelle Paris et les villes de la première couronne forment l'agglomération proprement dite. Les questions auxquelles les citoyens sont les plus sensibles, comme la pollution et la circulation, les transports, la pénurie de logements sociaux, l'aménagement et l'environnement sont traitées séparément par chaque commune, dans une situation de concurrence parfois, d'ignorance réciproque souvent, et cela parce qu'il n'existe aucune structure inter-communale, en l'absence de communauté urbaine. La Ville de Paris s'en satisfait assez, elle chez qui prévaut encore une pensée fossilisée, qui croit protéger Paris derrière le périphérique et consiste à garder ses richesses pour une minorité de privilégiés. Le monde a changé, il change encore : avec la banlieue, les relations doivent être institutionnelles et quotidiennes. Aussi, penser les questions que je viens de citer à l'échelle de l'agglomération est à la fois plus cohérent, plus efficace, et permettra de réduire les inégalités entre les communes. Encore faut-il que la collectivité territoriale qui prendra tout cela en charge ait une légitimité issue du suffrage universel, seul moyen de fonder une réelle identité d'agglomération, et une assise géographique adéquate, intermédiaire entre le cadre communal, trop étroit, et celui d'une région Ile de France trop vaste, dont la partie rurale ou semi- rurale est encore très importante. |
|||
|
|
J'ai
donc proposé que ce Haut-Conseil, élu au suffrage universel
direct, réunisse, outre Paris, les communes des départements
de la petite couronne, qui seront représentées au sein
de son organe délibérant au prorata de leur population.
Il prendra en charge, au titre des compétences de plein droit,
les transports et l'environnement, et à titre facultatif, l'aménagement
et l'habitat social. Il tirera ses ressources de la DGF et des recettes
de la taxe professionnelle à taux unique, ce qui lui permettra
de jouer un rôle de péréquation correcteur des inégalités
actuelles. Créer cette instance, c'est d'abord donner voix aux
citoyens dans la résolution des problèmes qui dépassent
le cadre communal ou départemental. C'est aussi mettre fin aux
clivages dépassés entre Paris et la banlieue, entre la
ville-mère résidentielle et ses villes-satellites, cités
dortoirs ou communes industrielles, ou résidentielles. C'est
enfin permettre à Paris de tenir son rang dans la compétition
internationale féroce que se livrent les métropoles européennes
pour accueillir les entreprises, donc développer l'emploi. Il
va de soi que cette proposition sera l'autre pierre angulaire de notre
projet pour Paris.
Ce projet, nous le voulons constructif et novateur, afin de redonner à Paris la première place au plan politique, culturel, social, universitaire, d'en faire une ville démocratique, novatrice, d'avant-garde, en relevant le citoyen. |
|||
|
|
Voilà, mesdames et messieurs, les propositions qu'à l'issue des brillants exposés entendus ce soir, et du riche débat qui s'en est suivi, je voulais vous présenter. L'avènement à Paris d'une véritable démocratie participative, fondée sur l'exercice actif de la citoyenneté, suppose une véritable alternative politique dans la capitale. En effet, qu'il s'agisse de la réforme de la loi PML ou de l'intercommunalité, les élus de l'actuelle majorité municipale se sont contentés d'effets d'annonce, mais n'ont jamais voté, pour ceux d'entre eux qui siègent à l'Assemblée nationale, les propositions qui auraient permis de donner un nouvel élan à Paris. Gérer au plus près des attentes des citoyens, développer l'identité d'agglomération qui existe déjà dans d'autres métropoles européennes, telles sont les idées-forces du Mouvement des Citoyens pour Paris. Elles vont dans le sens, non seulement des intérêts de notre capitale, mais du pays tout entier car, loin d'être une métropole qui asphyxie et désertifie nos régions, Paris est une locomotive pour le pays tout entier. Je vous remercie. |